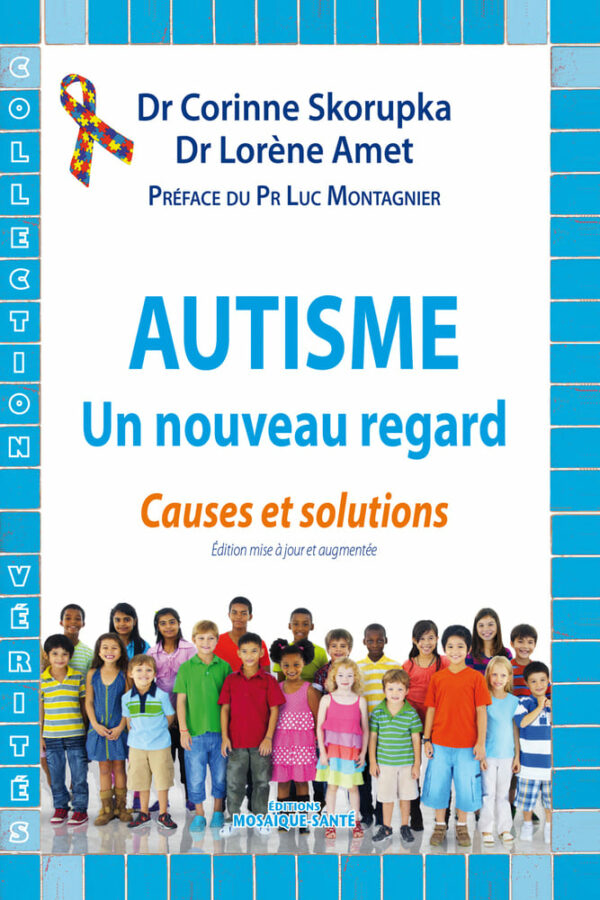L’autisme : facteurs, causes et solutions

À l’heure où l’on évoque le chiffre alarmant d’1 enfant sur 38 touché par les troubles envahissants du développement, il est temps de faire le point sur ces pathologies. Il est temps aussi de ne plus condamner d’emblée les enfants à la perpétuité autistique aggravée !
Les Drs Skorupka et Lorène Amet nous proposent, dans un ouvrage très complet, de faire le tour des connaissances et des solutions possibles. L’autisme n’est plus une fatalité.
- Dans son rapport de 2002, Prevalence of Autism Spectrum Disorders, le centre gouvernemental de contrôle des maladies des États-Unis estimait qu’à 8 ans, 1 enfant sur 152 était concerné.
- En 2009, l’étude rapportée par Simon Baron-Cohen dans le British Journal of Psychiatry évoque 1 enfant sur 63 parmi les enfants de 5 à 9 ans scolarisés au Royaume-Uni.
- En 2011, une étude sud-coréenne, parue dans l’American Journal of Psychiatry et menée par une équipe internationale de chercheurs américains, canadiens et sud-coréens, cite le chiffre d’1 enfant sur 38.
- En 2013, selon une estimation des autorités sanitaires américaines, 1 enfant sur 50 serait autiste aux États-Unis, une proportion en hausse chaque année !
- Les autorités sanitaires de nombreux pays se préoccupent à juste titre de l’accroissement majeur du nombre d’autistes.
- Fort de cette prise de conscience, le gouvernement français avait déclaré l’année 2012 « Année de l’Autisme » et l’autisme « Grande Cause Nationale ».
- D’après les chiffres officiels annoncés lors de ces débats, la maladie toucherait 1 enfant sur 110.
Qu’est-ce que l’autisme ?
L’autisme est un trouble du développement se manifestant au cours des trois premières années de la vie, parfois même dès la naissance. Les signes, multiples et d’intensité variable selon les enfants, se caractérisent essentiellement par des troubles de la communication pouvant aller jusqu’à l’absence de langage. Parmi les nombreux symptômes significatifs, citons : l’indifférence aux autres, la fuite du regard ou une difficulté à établir un contact visuel, l’absence de jeux avec les pairs, des comportements stéréotypés ou compulsifs, une angoisse et une résistance aux changements, des difficultés à saisir l’abstrait et l’implicite, à décoder l’environnement, le tout associé parfois à des compétences très pointues dans d’autres domaines…
La génétique, mais pas seulement…
Beaucoup d’espoirs sont aujourd’hui placés dans la recherche génétique, qui présente en particulier l’avantage de déculpabiliser des familles longtemps éreintées par la psychanalyse, qui a pourtant démontré son incapacité à proposer des voies thérapeutiques efficaces.
Cependant, les prédispositions génétiques ne suffisent pas à expliquer l’accroissement du nombre de cas. Certes, la génétique identifie, ici et là, des variations de gènes présentes ponctuellement dans certaines déclinaisons du spectre autistique, mais n’apporte encore aucune réponse à l’autisme dans sa globalité.
Certains affirment que son augmentation est simplement le résultat d’une meilleure connaissance, notamment en matière de diagnostic. Si on ne peut nier que les diagnostics sont mieux établis, il est de notre devoir de réfléchir sérieusement à la question afin de tenter de comprendre ce qui peut être à l’origine de ces chiffres alarmants et tout mettre en œuvre pour inverser la tendance.
Une maladie aux multiples facettes
L’autisme est un trouble aux multiples déclinaisons. Chaque cas est unique. En schématisant à l’extrême, il est cependant possible de scinder la maladie en deux catégories : l’autisme syndromique, dont les origines seraient génétiques et qui apparaît fréquemment dès la naissance, et un autisme régressif, vraisemblablement provoqué par des facteurs environnementaux. Les causes possibles sont diverses, allant d’anomalies génétiques à des atteintes infectieuses ou toxiques, et peuvent être cumulatives.
Les pistes de compréhension qui commencent ainsi à s’esquisser orientent vers des traitements ciblés en mesure d’améliorer la symptomatologie, voire de l’inverser.
Cette éclosion soudaine de nombreux cas d’autisme pourrait trouver un début d’explication dans les modifications de notre environnement et de nos modes de vie actuels : pollutions cachées et multiples, nutrition « dénaturée et industrialisée », exposition croissante aux métaux lourds toxiques comme le mercure, les pesticides et autres polluants, exposition permanente aux radiations électromagnétiques de toutes fréquences, évolution de la flore microbienne…
L’environnement
La fabrication de nouveaux produits chimiques a connu au siècle dernier une augmentation exponentielle, jamais observée jusque-là à l’échelle planétaire. Ces produits, comme les pesticides et les solvants industriels, sont souvent nuisibles et toxiques.
Personne ne conteste aujourd’hui que la biodiversité est menacée : le taux d’extinction d’espèces animales et végétales n’a jamais été aussi élevé depuis l’ère des dinosaures et de nombreuses espèces de poissons disparaissent en raison de la pollution des océans.
Le rythme des changements climatiques observés partout dans le monde est plus rapide que quiconque ne l’avait prévu il y a seulement quelques années.
Nous sommes confrontés à une augmentation du nombre de maladies dont le cancer, les maladies chroniques, auto-immunes et neuro-dégénératives. Pourquoi les enfants seraient-ils épargnés ?
Compte tenu de leur fragilité et de leur système immunitaire immature, il y a toutes les raisons de s’attendre à ce que leur cerveau et leur corps en développement soient particulièrement affectés.
Une maladie multifactorielle
Un seul facteur, un seul agent infectieux ou toxique n’est à lui seul responsable de l’augmentation des cas d’autisme. L’autisme est une maladie multifactorielle.
Mais il est logique de penser que la combinaison des expositions aux produits dangereux modifie notre biochimie et perturbe le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Ajouter à cela une vulnérabilité génétique, et une goutte d’eau peut faire déborder le vase…
Ainsi, la présence inquiétante des métaux lourds dans l’environnement est sans doute pour beaucoup dans la genèse de l’autisme. En effet, un facteur très clairement impliqué dans l’autisme est l’intoxication au mercure. Pour des raisons peut-être génétiques que l’on tente de cerner, certains enfants plus fragiles semblent particulièrement vulnérables face à ce puissant neurotoxique.
La multiplication des ondes électromagnétiques semble aussi jouer un rôle essentiel dans la genèse de l’autisme et il est probable qu’elle contribue à son augmentation.
La pièce manquante du puzzle…
Une étude menée par l’équipe du Pr Montagnier en 2009 décrit les propriétés inédites de l’ADN d’agents infectieux, d’origine bactérienne notamment, qui émettent des signaux sous forme d’« ondes électromagnétiques dans l’eau ». On retrouve ces signaux non seulement chez les enfants autistes, mais aussi dans des pathologies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Absents, en revanche, chez les enfants non atteints, ces signaux seraient apparemment émis par des espèces bactériennes connues, d’origine intestinale.
Il ressort de cette étude qu’un dysfonctionnement immunitaire, associé à une inflammation de la muqueuse intestinale, entraîne un passage de toxines bactériennes dans la circulation sanguine. Véhiculées par le sang, ces toxines franchiraient ensuite la barrière cérébrale rendue perméable par les radiations électromagnétiques, créant dans le cerveau des phénomènes inflammatoires, un stress oxydatif et une mauvaise oxygénation à l’origine de troubles neurologiques.
Ces découvertes ouvrent la voie à un traitement des infections bactériennes chroniques et à une nouvelle approche thérapeutique.
Et si l’autisme était le signal d’alarme avant qu’il ne soit trop tard…
Comprendre, c’est aussi agir et traiter. L’autisme est potentiellement curable s’il est décelé et traité très précocement, et à condition d’associer au traitement une éducation structurée intensive et spécifique.
Certains enfants autistes progressent vers la guérison de manière plus rapide ou plus significative que d’autres. Il est de notre devoir de mettre en place les thérapies les plus appropriées à chaque cas individuel et c’est la raison pour laquelle nous en dressons l’inventaire dans ces pages.
Afin que le traitement se déroule dans les meilleures conditions possibles, il est nécessaire d’établir de nombreux partenariats : entre les médecins et les parents, les psychologues, les éducateurs, les enseignants.
| L’exemple de Damien Damien a 4 ans lorsque sa mère rédige le récit qui suit… Il en a 17 aujourd’hui. Arrêté dans son glissement sur la pente de l’autisme grâce au régime d’éviction du gluten et du lait et à un traitement de désintoxication, il sait de quoi il a réchappé. À 15 mois, Damien a cessé de parler, de jouer, d’interagir, perdu le goût et la capacité d’apprendre. Aujourd’hui, il est dans les 10 premiers de sa classe. Le lycée qui le scolarise à temps plein en seconde ignore tout de son passé autistique. S’il évoque ce problème, on lui répond qu’il n’a pas pu être autiste, car l’autisme, « on n’en guérit pas ». Mais lui est bien conscient de la nécessité de respecter un régime qui fait de lui un rescapé. Témoignage de la maman de Damien « Mon fils Damien a presque 4 ans au moment où j’écris ces lignes. C’est un enfant quelque peu différent des autres. Cette « différence », je ne lui donnerai pas de nom car je n’aime pas mettre d’étiquettes sur quelque chose d’aussi abstrait et subjectif que le comportement d’un enfant, et cela d’autant moins qu’aucun médecin n’a pu porter sur son cas de diagnostic ferme. À ce jour, je dirais simplement que mon fils présente un retard de langage par rapport aux autres enfants de son âge. Consciente qu’il revient de bien plus loin, je suis relativement optimiste quant à l’avenir sans savoir encore vraiment de quoi il sera fait. J’ai souvent eu l’envie de partager cette expérience avec d’autres parents au travers d’un témoignage que je voudrais toutefois prudent. Je ne souhaite pas que ce récit soit mal interprété. Il ne constitue pas une affirmation de l’efficacité des diverses approches que j’ai pu entreprendre ; il naît simplement du désir de relater des faits troublants. Ne voulant pas occasionner de déceptions chez des parents qui n’obtiendraient pas les mêmes résultats, je tiens à signaler que chaque enfant est différent et réagit donc différemment. De plus, comme dans le cas de mon fils, tous les termes possibles ont été employés pour expliquer la « différence » qu’il présentait (épilepsie, syndrome de Landau Kleffner, aphasie, forme d’autisme, autisme débutant, TED), sans qu’aucun puisse être considéré comme définitif, je m’en tiendrai purement à mes propres constatations dans les diverses étapes de son développement. « Forme d’autisme » : c’est en mars 1999 – Damien a presque 2 ans et demi – que ce terme est lâché brutalement par une pédopsychiatre. Je reste sans voix, je ne comprends pas. « Forme d’autisme », qu’est-ce que cela veut dire ? Damien ne peut pas être autiste, il a toujours évolué d’une façon très précoce, dans tous les domaines… Les souvenirs repassent très vite devant mes yeux : il tenait assis à six mois, marchait à un an, a dit ses premiers mots vers cet âge-là. À quinze mois, il connaissait toutes les parties de son corps et savait faire au revoir avec la main, cligner de l’œil, faire les marionnettes… Cette pédopsychiatre se trompait, mon fils ne pouvait pas avoir de « forme d’autisme » : il avait parlé, joué, rigolé, touché à tout, fait le clown, imité son frère, etc. Bien sûr, si nous étions là, c’est qu’il s’était passé quelque chose que je ne comprenais pas. Damien avait commencé à changer vers 15 mois, puis avait cessé de parler vers 18 mois. Tout s’embrouillait dans ma tête. Je suis rentrée, j’ai regardé les photos, j’ai appelé ma pédiatre ; non, elle n’y croyait pas non plus, il fallait être sûr, faire des examens neurologiques pour voir s’il n’y avait pas une autre cause à ses problèmes. Je reprenais espoir. (…) depuis ses 15 mois, il n’est plus le même, il est devenu capricieux, colérique, impossible à canaliser. À dix-huit mois, il a cessé de parler et s’est mis à utiliser mon bras pour atteindre un verre d’eau. Dans les six mois qui ont suivi, son comportement n’a cessé de se dégrader, il s’est replié sur lui-même, allant parfois jusqu’à refuser qu’on le touche. De deux ans à deux ans et demi, la situation est devenue catastrophique, il était absent, ailleurs, il jouait sans cesse avec les mêmes jouets, de la même façon, il ne s’intégrait pas aux groupes d’enfants de la crèche, il avait tendance à s’occuper seul dans des activités assez stéréotypées. Il se réveillait plusieurs fois par nuit, devenait difficile à nourrir, sélectif et exclusif dans les aliments qu’il consommait, ne s’intéressait à rien, refusait d’entrer dans un square où il y avait d’autres enfants, fuyait les regards, allant jusqu’à cacher ses yeux devant le regard d’un inconnu, et ne manifestait plus aucune joie en notre présence. De jour en jour, je le voyais partir plus loin dans un autre monde, un monde à lui seul, et j’étais impuissante : je savais qu’il y avait quelque chose, mais quoi ? (…) C’est par un hasard extraordinaire qu’un mois plus tard, je devais être mise en relation avec une maman, devenue par la suite une amie, dont les deux enfants avaient connu le même développement précoce que Damien, puis la même régression, au même âge, et qui me raconta leur histoire ainsi que celle de dizaines d’autres enfants qu’elle connaissait. J’écoutais, avide de comprendre. Ce fut bref, et je la crus tout de suite. Son récit était incroyable, mais je n’avais aucun doute. La majorité (80 %) des enfants comme Damien, me dit-elle, souffrent de perméabilité intestinale. Dans ce syndrome, l’intestin endommagé permet à des bactéries, des toxines et des particules non digérées de pénétrer dans le flux sanguin. Cette perméabilité peut induire des allergies alimentaires, des diarrhées chroniques ou même des constipations. Et, ajouta-t-elle, dans ce contexte, le gluten et les protéines du lait deviennent particulièrement redoutables. Ces protéines, pas entièrement assimilées sous forme d’énergie utilisable (acides aminés), demeurent sous la forme biologique de peptides ayant une action « opioïde ». S’ils passent la barrière intestinale, ces peptides opiacés agissent sur le cerveau exactement comme de la morphine : ils provoquent une dépendance affectant la transmission neurologique et pouvant induire ensuite des difficultés de comportement et de langage typiques de l’autisme, une dyslexie, un déficit d’attention. En raison d’une déficience immunologique qui empêche leur système digestif de décomposer convenablement le gluten et la caséine (protéines contenues dans les produits laitiers de toute origine), ces enfants sont comme « drogués ». Il s’ensuit un effet de manque et, par conséquent, des compulsions pour les aliments contenant ces protéines. Une première bouchée semble améliorer un état dépressif, voire donne un sentiment d’euphorie et de bien-être. Malheureusement, ces sensations ne durent pas. Une ou deux heures plus tard, elles sont suivies de dépression, d’anxiété et d’abattement, ce qui pousse les enfants à consommer de nouveau les aliments dont ils deviennent totalement dépendants. Ils régressent, se perdent dans leur monde et perdent aussi toute capacité intellectuelle ainsi que l’accès au langage. S’ensuivent des troubles du comportement qui confirment le diagnostic d’autisme. Elle m’orienta vers de nombreux sites Internet et témoignages de parents confirmant ses dires de manière très claire. Tous les articles que je lisais (venant de l’étranger pour la plupart) racontaient la même chose. Tous les témoignages de parents qui avaient essayé le régime d’exclusion du gluten et de la caséine encourageaient à l’entreprendre au plus vite pour son effet des plus bénéfiques sur le comportement, le langage et les apprentissages. Ce régime pouvait éliminer ces substances dangereuses du système de l’enfant. Il devait être strict, à 100 % strict, et plus l’enfant le commencerait jeune, plus les résultats réels seraient rapides. Chez des enfants plus âgés, les résultats pouvaient être impressionnants, mais prenaient jusqu’à un an avant de se manifester. Cette théorie de « dépendance compulsive pour une forme de drogue » expliquait bien des choses. Aussi invraisemblable puisse-t-elle paraître, elle ne l’était pas pour moi. À maintes occasions, j’avais été sidérée de voir mon enfant avaler une baguette de pain et en réclamer davantage une heure plus tard. Il pouvait sortir de table après un repas copieux et devenait comme fou s’il voyait un bout de pizza. J’avais comme cela des tas de souvenirs presque choquants. Par exemple, cette fête de fin d’année de la crèche où tous les enfants regardaient le Père Noël et attendaient leurs cadeaux. Damien était déjà au buffet et avalait canapé sur canapé. Son cadeau, il ne l’avait même pas regardé, il mangeait. Il avait commencé avant tout le monde et, deux heures plus tard, alors que personne n’avait plus faim, il mangeait encore. Aucun adulte n’aurait pu en avaler autant. De peur qu’il soit malade, j’essayais de l’éloigner du buffet ; il hurlait. Une semaine plus tard, à la fête de fin d’année de ma société, il recommençait, mangeant sans interruption de 15 heures à 18 heures. Juste après, Il avait l’air heureux, « rassasié » aurais-je dit à l’époque, – aujourd’hui je dirais « shooté » – à en éclater de rire sans raison, comme ivre. Des souvenirs comme ceux-là, il m’en revenait des dizaines à présent. Et c’est vrai que Damien avait une nette préférence pour les aliments qui contenaient du gluten ; il n’était pas aussi vorace quand il s’agissait de pommes de terre ou de riz, qu’il refusait même parfois carrément jusqu’à ce que je lui fasse une assiette de pâtes, qu’il mangeait toujours ! Dans son intérêt, je me devais de lui faire suivre ce régime. Je n’avais pas grand-chose à perdre et peut-être tout à gagner. Il ne consommait déjà plus de produits laitiers depuis le test d’intolérance au lactose. Le lait étant remplacé par le lait de soja enrichi en calcium, il me restait à contourner le gluten, ce qui n’allait pas être une mince affaire dans la mesure où il s’agissait alors de la base de son alimentation. Au départ, j’étais perdue, mais petit à petit, j’arrivai à composer des menus équilibrés avec un support féculent (riz, pomme de terre), un légume, une viande et une compote de fruits comme dessert. J’avais plus de mal pour le petit déjeuner, mais je finis par y arriver avec des galettes de riz ou des gâteaux maison à base de farine de châtaignes ou de farine de riz pour remplacer le blé, le seigle, l’orge, et l’avoine, qui contiennent du gluten. Ne voulant pas me laisser influencer, je ne dis rien à ma famille et notais chaque jour sur un agenda ce qui se passait. Au début, Damien semblait aller plus mal, il se montrait plus grincheux, plus difficile que d’ordinaire. Comme je m’en inquiétai auprès de mon amie, elle me répondit que c’était normal, qu’il allait y avoir une période de sevrage pendant laquelle l’organisme allait reprendre ses repères. Je continuai donc en considérant que mon fils était, pour ainsi dire, en cure de désintoxication. Le mot semblera lourd à certains, mais c’est ainsi que j’ai ressenti les choses les premiers temps. J’attendais avec impatience des événements plus encourageants : ils ne furent pas longs à venir, j’en garde un souvenir très précis. C’était un samedi après-midi, je regardais Damien ébahie, comme si j’avais vu un fantôme. Il ne faisait pourtant rien d’extraordinaire, il jouait avec un bateau, il le faisait naviguer. Mais pour moi, c’était magique : depuis près d’un an, je n’avais jamais vu mon fils jouer avec ce bateau, il passait invariablement ses journées à manipuler des petits animaux en plastique, encore et toujours. Ce jeu si pauvre m’avait désespérée plus d’une fois. Et voilà qu’à présent, il se mettait à regarder des livres, à écouter des histoires, à pousser un petit train. Et puis il y eut ce mot : « merci », qui me remplit de joie, le premier qu’il prononçait depuis un an. Alors je lui demandai où était son nez, et il mit son doigt dessus. J’enchaînai, « et tes yeux ? », « ta tête ? », « ton ventre ? », « tes mains ? ». Tout, il montrait tout, j’en aurais pleuré. Il connaissait les parties de son corps, avant, mais avait depuis si longtemps cessé de participer à ce petit jeu ! Nous étions en juin 1999, Damien suivait le régime sans caséine depuis deux mois et sans gluten depuis un mois ; ses progrès étaient spectaculaires (…). Tous les neurologues connaissent l’efficacité du régime cétogène (un régime à base d’acides gras en majorité NDLR) dans les cas d’épilepsie réfractaire aux antiépileptiques, et tous le conseillent en dernier recours. Ce régime est admis sans autre preuve de son efficacité que celle d’avoir été tenté avec succès. Alors pourquoi n’en était-il pas de même avec le régime sans gluten ni caséine ? Parce que peu de parents en connaissaient alors l’existence et le tentaient ? Parce qu’il n’était pas étayé par suffisamment de preuves scientifiques ? Ou bien parce qu’il était tout simplement inconcevable que la simple éviction de deux aliments aussi courants que le lait et le gluten puissent permettre de sortir d’un trouble aussi profond que l’autisme ? Je comprenais qu’à moins de prouver que Damien avait bien une pathologie de perméabilité intestinale, le reste ne voulait rien dire. J’étais consciente aussi que ce mécanisme ne pouvait faire appel qu’à une fonction métabolique complexe et qu’il me faudrait passer par des analyses qui mettraient en évidence des défauts enzymatiques, des carences vitaminiques, des déséquilibres divers, des allergies alimentaires et un système immunitaire défaillant. Je repris donc tous les textes lus sur Internet et dressai la liste des anomalies métaboliques retrouvées chez les enfants présentant un comportement autistique. Je fus moi-même surprise de voir que ce trouble soi-disant « psychiatrique » était largement documenté à l’étranger comme un désordre biologique, mais la liste impressionnante des pièces de ce puzzle si complexe m’effrayait. N’ayant aucune formation médicale ou biochimique, il me fallut me familiariser avec beaucoup de termes médicaux. J’imprimais tout ce que je pouvais et lisais jusqu’à deux heures du matin pendant que mon fils dormait. Je finis par dresser une liste non exhaustive des examens prioritaires et choisis de commencer par ceux pouvant expliquer la diarrhée chronique. J’étais persuadée que Damien évoluerait davantage si on déterminait l’origine de ses symptômes. (…) Aujourd’hui, à quatre ans, Damien n’a plus aucun trouble du comportement, ses rires ont remplacé ses cris stridents, il chante dans son bain, comprend tout, compte jusqu’à vingt, connaît les couleurs, les formes, réclame les copains pour ses sorties du week-end. Il aime la compagnie, l’école, le centre de loisirs et, malgré un langage encore restreint, il arrive à composer de vraies phrases, à manifester oralement tous ses désirs, et je fonds quand il me demande : « Un gros bisou ou un petit bisou ? ». Il réussit assez bien dans les activités faisant appel à la logique et à la volonté d’apprendre. L’IRM et l’EEG ne montrent plus aucune anomalie et si je suis encore loin de comprendre parfaitement comment fonctionne son métabolisme, je sais tout au moins qu’il n’est plus autiste, mais aussi qu’il y a sans doute une différence fondamentale entre « être autiste » et avoir un « comportement autistique ». Personne dans le milieu médical ne peut expliquer la régression qu’a connue Damien à 15 mois, les troubles envahissants du développement, ni la normalisation de l’EEG et de l’IRM ou la reprise des acquisitions sous le régime sans gluten et sans caséine. Quant à ce régime, lorsque j’y fais allusion, c’est pour m’entendre dire qu’il n’y a pas de preuves scientifiques de son efficacité. Ma seule constatation est que le moindre écart provoque des semaines difficiles avec réveils la nuit, irritabilité, cris, régression dans le langage. Si je crois toujours que ce régime apporte énormément à mon fils au niveau concentration et apprentissage, je remercie aussi les gens qui l’ont aidé dans le milieu scolaire et l’ont accueilli comme n’importe quel enfant. » Les remarques du Dr Skorupka Damien a aujourd’hui 17 ans. Scolarisé dans des conditions tout à fait ordinaires en première, il ne reste plus rien de son cursus autistique. Pendant très longtemps, il a conservé une hyperactivité confirmée à l’âge de 10 ans par l’hôpital Necker, mais tempérée par le maintien d’un régime très strict (outre l’éviction du gluten et du lait, du maïs et du soja, Damien ne consomme que très peu de sulfates, fruits rouges, coca, chocolat, sucres). Son année de retard, il la doit à un redoublement du CM1 demandé par ses parents à la suite d’un déménagement. Son agitation, qui, à un moment donné, a fait se poser la question du possible intérêt de la Ritaline pour finir de « normaliser » son comportement à l’école, a totalement cessé après deux cures de Zithromax prescrites lors de la découverte d’une infection à streptocoque. Damien fait aujourd’hui partie des 10 meilleurs élèves de sa classe. Avec un QI de 150 bien équilibré, il est curieux, apprend vite, et a probablement conservé de son passé autistique une mémoire au-dessus de la moyenne. Vif d’esprit, il a de bonnes capacités de raisonnement, comprend les jeux de mots, l’implicite, sait faire preuve d’empathie. À l’instar de nombre de ses pairs, à 17 ans, il a un avis sur tout et ne se prive pas de l’exprimer… Seul « réglage » manquant ou simple travers de son âge qui lui cause parfois quelques ennuis, il ne se prive pas non plus de reprendre, ici et là, ses professeurs… Sociable, il a des copains dans la cour de récréation, pratique le scoutisme, le basket, le modern jazz, sort avec ses copains, mais maintient toujours un régime très strict, car les troubles digestifs réapparaissent au moindre écart. Sa mère s’est beaucoup battue à une époque où le mouvement de médecins et chercheurs américains Defeat Autism Now ! n’avait pas encore l’ampleur que nous lui connaissons aujourd’hui, et où seuls les témoignages anecdotiques de quelques parents sur Internet pouvaient servir de balises. Outre le régime d’éviction d’aliments tels que gluten, lait, maïs et soja, la restriction des sulfates, phosphates, colorants, sucres, chocolat, aliments phénoliques et le recours à l’alimentation biologique, un traitement de nutrithérapie et de chélation a été mis en place au fil des ans. Parallèlement à une détoxication hépatique, Damien a pris des chélateurs tels que de l’EDTA pour le plomb et l’aluminium, du DMSA pour le mercure, et de l’acide alpha-lipoïque. Et pour combler ses carences ou les prévenir, des compléments alimentaires tels que calcium, B12, MB12, carnitine, magnésium, zinc, sélénium, fer, omégas 3. Sa mère a toujours refusé tout fatalisme. (…) |
| Témoignage de Jean-Charles, adolescent autiste « Maman, aujourd’hui je veux parler du coup de téléphone que Corinne t’a passé. Je suis très content car il faut bien expliquer aux gens ce qu’est l’autisme car ils ne comprennent pas du tout ce que c’est. Il faut leur expliquer que les enfants autistes sont très intelligents et très malheureux. Je veux que tout le monde comprenne que nous ne sommes pas ce que nous paraissons, par exemple nous faisons les imbéciles quand on nous voit comme des débiles mais nous montrons notre intelligence quand on nous aime et qu’on nous aide à bien marcher et à avancer. Je pense que nous devons bien expliquer à tout le monde que les enfants autistes sont très gentils et dire à tout le monde que les enfants autistes ne doivent pas être mis à l’écart du monde car ils veulent participer à la vie normale et ils ne veulent pas être rejetés car ils aiment beaucoup les gens et ils veulent que tout le monde soit heureux. Ils ne veulent pas être mis ensemble car ils ont tous beaucoup trop de peine à avancer et ils doivent plutôt être entourés de gens de qualité qui ont beaucoup de cœur et qui vont faire ce qu’il faut avec eux, comme Corinne ou Maryvonne ou Karine ou Mme Boudot-Redy ou Sylvie, ou Lucie ou Céline, ou Camille ou encore Catherine R., ou la prof d’Arts Plastiques, ou le prof d’Aïkido, ou les gentils profs du Collège du Village. Je pense aussi à Fiona qui a trouvé enfin que j’étais intelligent et elle a passé beaucoup de temps avec moi pour me tester car j’étais très lent et elle a eu beaucoup de patience, et sans elle on penserait toujours que je suis débile mais grâce à elle on sait que je sais beaucoup de choses. J’ai aussi beaucoup été aidé par Odile qui m’a débloqué plein de nœuds énergétiques et m’a donné beaucoup d’amour. » |
Les auteures de l’ouvrage
Le Dr Corinne Skorupka est spécialiste du traitemet des TED et de l’autisme et travaille depuis de nombreuses années sur le sujet. Elle a créé une association, l’Association Ariane, spécialisée dans l’approche biomédicale de l’autisme. Première en France à s’intéresser aux avancées médicales concernant le traitement de l’autisme (notamment aux États-Unis), elle milite pour une prise en charge différente en France et, ces dernières années, travaille en collaboration étroite avec le Pr Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine.
Le Dr Lorène Amet, Docteur es-sciences spécialisée en neurosciences, consacre sa vie à la recherche sur l’autisme depuis près de 10 ans, suite à la découverte de l’autisme de son fils. Directrice scientifique au sein de l’organisation britannique Autism Treatment Trust pendant 8 ans, elle a ensuite développé sa propre organisation, Autism Treatment Plus, qui permet aux familles d’avoir accès à des services d’intervention, de diagnostic, de traitement biomédical ainsi qu’à des supports éducationnels. Elle travaille également pour le gouvernement écossais à l’élaboration d’une stratégie globale de traitement de l’autisme.