Adieu Daniel Kieffer
Un grand naturopathe nous a quittés
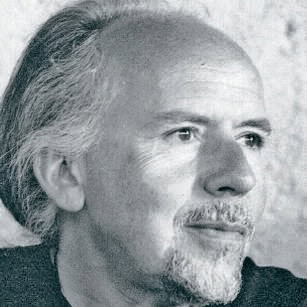
Auteur de nombreux ouvrages sur la santé holistique, Daniel Kieffer était aussi un naturopathe reconnu de ses pairs qui œuvrait depuis toujours pour la reconnaissance de sa pratique. Fondateur du Cenatho (Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique), il transmettait son savoir depuis près de 35 ans et, tout en ayant passé la main à la direction, continuait à y diffuser son savoir. Co-fondateur de la première fédération des écoles de naturopathie, il défendait la profession avec courage, se battant pour la reconnaissance officielle de cette méthode de prévention. Au début des années 2010, il avait été auditionné au Sénat lors d’une commission d’enquête intitulée « Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger ». Il avait alors débuté l’entretien avec sa définition de la naturopathie. Il m’a semblé que lui donner la parole serait une belle façon de le remercier de son engagement pour la santé de toutes et tous.
Invité à « prononcer un court exposé introductif » par la présidente de la commission, voici ce qu’il avait répondu :
« Je me réjouis d’avoir l’opportunité historique d’ouvrir un dialogue transparent avec les élus de la Nation, et vous en remercie chaleureusement, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais faire une présentation très simple de notre discipline, la naturopathie. Elle est née aux États-Unis, où le mot apparaît pour la première fois en 1896. En 1902 est fondée la première école, dans l’Oregon, et, à la veille de la crise de 1929, la naturopathie compte quelques milliers de professionnels et vingt écoles.
Ce courant hygiéniste se développe en Europe dans les années 1935-1940, où sont fondées les premières écoles, de façon informelle à l’époque et empirique. Il faut attendre 1985 pour voir naître la Fédération française de naturopathie (Fenahman), qui regroupe les principaux chefs d’école. Le niveau de compétence, l’éthique et la déontologie de la profession sont établis. En 1982 était née l’Omnes (Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire), l’association à vocation syndicale de la profession, qui donne accès à l’assurance professionnelle et qui assure également la formation continue.
Une autre date intéressante : à la suite du rapport Collins-Lannoye, la résolution européenne du 29 mai 1997 invite les États membres à considérer avec bienveillance l’intégration des médecines dites non conventionnelles dans les pays membres. En 2000, la naturopathie était intégrée dans dix États membres sur quinze, notamment en Allemagne et dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne, etc.
Elle se définit comme la synthèse des méthodes naturelles de santé, à vocation préventive, éducative et pédagogique. Elle promet également le rétablissement de la santé dans les troubles mineurs, lorsqu’un diagnostic préalable a été posé par le médecin, en améliorant la qualité et l’hygiène de vie. Le naturopathe est un éducateur de santé. Son champ d’action, comme le recommande l’OMS (Organisation mondiale de la santé), est la prévention active primaire, passant par l’hygiène et la qualité de vie, le bien-être au sens global, tel que l’entend la définition de la santé de l’OMS.
La naturopathie se situe davantage du côté des médecines naturelles que des médecines douces (homéopathie, mésothérapie, acupuncture, phytothérapie, aromathérapie…) dont l’exercice relève de la médecine. Ces disciplines ne sont pas enseignées en naturopathie. La naturopathie ne pose pas de diagnostic et ne propose pas de traitement de maladie : elle vise la prévention, la promotion de la santé et de la qualité de vie. Lorsque nous recevons des personnes atteintes de troubles mineurs, nous ne faisons jamais ingérence dans un traitement médical en cours : nous coachons, nous délivrons des conseils portant sur l’alimentation – en insistant sur les bénéfices de l’alimentation bio –, sur l’hygiène corporelle, la gestion du stress, le contact avec les éléments naturels, la qualité du sommeil ou de la respiration, avec une conscience écologique, bien évidemment. »



