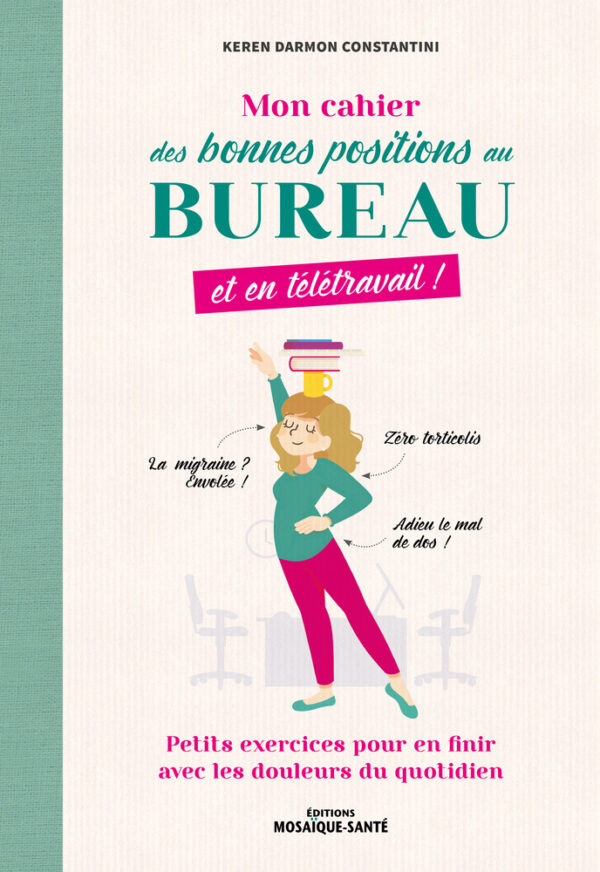Le fascia, un tissu méconnu aux vertus insoupçonnées

Il y a encore quelques années, le fascia, ce tissu conjonctif omniprésent dans tout notre corps, était le grand oublié des anatomistes. Souvent écarté d’un revers de scalpel et boudé des livres d’anatomie, il ne semblait jouer qu’un faible rôle pour le corps. Vilain petit canard de l’anatomie, le fascia est aujourd’hui devenu un véritable cygne, au centre des recherches scientifiques. Il apparaît comme un acteur clé de notre corps. Réseau de soutien et d’information, ce cygne anatomique n’a pas fini de révéler ses secrets.
Le fascia, qu’est-ce que c’est ?
Le tissu fascial est un tissu conjonctif blanc argenté présent dans tout le corps, sous la peau mais aussi en profondeur. Carla Stecco, chirurgienne orthopédiste et présidente du département d’anatomie de l’université de Padoue, a consacré une grande partie de sa vie à son étude. Elle a défini cette membrane comme « une gaine, une feuille ou tout autre agrégat dissociable de tissu conjonctif se formant sous la peau pour relier, enfermer et séparer les muscles et autres organes internes.«
Chez un adulte, il pèserait une vingtaine de kilos. Il forme un réseau qui relie et soutient l’ensemble des structures du corps (les muscles, les os et les organes internes). Pour Andry Vleeming, professeur d’anatomie connu pour ses recherches sur la biomécanique du bassin et de la colonne vertébrale, il s’agit en quelque sorte de notre « squelette mou ».
Pour comprendre le rôle de soutien de ce maillage, je vous invite à visualiser l’intérieur d’un pamplemousse. Quand vous le pelez, vous tombez d’abord sur une couche blanchâtre. Puis coupé en 2, vous pourrez observer que cette couche blanchâtre se poursuit par une composante fibreuse qui va soutenir la pulpe et diviser le fruit en quartiers. De manière similaire, dans le corps humain, le tissu fascial agit comme un réseau de fibres reliant et soutenant les différentes structures de notre corps lui permettant de rester stable tout en lui offrant souplesse et mobilité. Le fascia est un tissu omniprésent qui isole chaque partie du corps tout en les connectant.
On distingue différents types de fascias selon leur emplacement :
- Le fascia superficiel, également nommé fascia adipeux. C’est un tissu fibreux, mais très élastique. Il est situé juste sous la peau et la sépare des muscles. Il permet un mouvement optimal en faisant glisser les tissus l’un sur l’autre. Il a également un rôle de thermorégulateur.
- Le fascia profond, quant à lui, est une couche fibreuse recouvrant le muscle, une sorte de collant. Chez le boucher, vous pouvez l’observer sous la forme d’une « peau argentée » qui recouvre certaines pièces de viande. Le fascia profond forme un réseau de soutien qui permet aux muscles de glisser les uns sur les autres. Il contribue aussi à maintenir la stabilité du corps. Il joue un rôle important dans la transmission des forces entre les muscles et les articulations.
- Le fascia méningé entoure le cerveau et le système nerveux, et le fascia viscéral est présent autour des organes abdominaux, du cœur et des poumons.