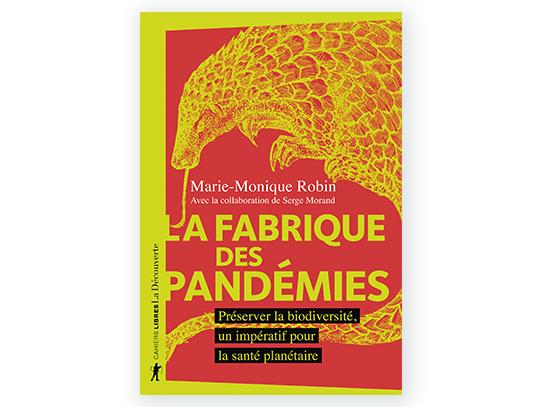Les algues : un monde d’actifs cosmétiques à découvrir

Notre connaissance des organismes marins est encore limitée et ne s'étendrait qu'à 20 ou 30 % des espèces existantes. Et sur les 40 000 répertoriées à la surface du globe, seules 40 sont utilisées aujourd'hui en cosmétique. Mais les recherches avancent et les algues, avec leur immense diversité et leurs multiples propriétés, sont et seront de plus en plus présentes dans nos produits.
La mer est une source extrêmement riche d’actifs pour les produits cosmétiques et elle constitue un espace de biodiversité unique, qui tient à l’ancienneté de la vie marine : 3,8 milliards d’années.
Au premier rang des actifs marins, les algues présentent de grandes similitudes avec l’organisme humain, et notamment leur matrice extracellulaire assez similaire à celle de l’homme. D’après certains experts, nos cellules reconnaissent mieux les molécules issues des algues que celles provenant des plantes terrestres.
Riches de diversité
Mais, si elles existent depuis toujours, on les connaît encore assez mal. C’est que, s’il y avait un seul type d’algues, le problème de leur étude serait assez simple. Mais elles s’avèrent être d’une incroyable diversité.
Chacune a ainsi un ADN unique qui lui confère des spécificités, des dons différents. Toutes sont ainsi génétiquement spécifiques, et certaines même ne sont pas des plantes ! Rappelons aussi que les algues ne sont pas une exclusivité des milieux marins, puisque certaines se développent également dans les eaux douces des lacs ou des rivières.
Pour les marines, elles sont d’abord de différentes couleurs : vertes, brunes, rouges… on a même un temps parlé d’algues bleues pour désigner certaines bactéries. Et si on associe communément les algues aux macroalgues, ces « grandes » algues visibles à l’œil nu en bord de mer, elles sont aussi de tailles différentes, jusqu’aux microscopiques microalgues et au plancton.
Riches de molécules actives
Apparues il y a 3,6 milliards d’années, les algues sont talentueuses et puissantes, capables de résister et de s’adapter aux conditions les plus extrêmes, et d’une richesse exceptionnelle en molécules bioactives.
On peut ainsi citer :
> des minéraux et des oligo-éléments,
> des pigments (chlorophylle, phycobiliprotéines…),
> des caroténoïdes (fucoxanthine, asthaxanthine, ß-carotène),
> des phlorotannins et des acides phénoliques,
> des polysaccharides,
> de l’iode,
> du mannitol,
> des stérols,
> des protéines et des acides aminés,
> des acides gras essentiels (Oméga 3, 6 et 9),
> des terpènes,
> des composés halogénés,
> des vitamines A, B, C, E…
Pour lire la suite
Fondé en 1998 par Sophie Lacoste, journaliste passionnée par les plantes et leurs bienfaits, Rebelle-Santé est un magazine totalement indépendant. Chaque article est soigneusement rédigé par humain spécialisé dans le sujet. Rebelle-Santé ne pratique pas la publicité déguisée.
En vous abonnant, vous recevrez chez vous 10 numéros par an et 1 à 4 hors-séries. Vous aurez également accès à plus de 11 000 articles et à 45 nouveaux articles chaque mois.
Comme tout média indépendant, Rebelle-Santé a besoin de vos abonnements pour continuer à exister.
Déjà abonné·e ?