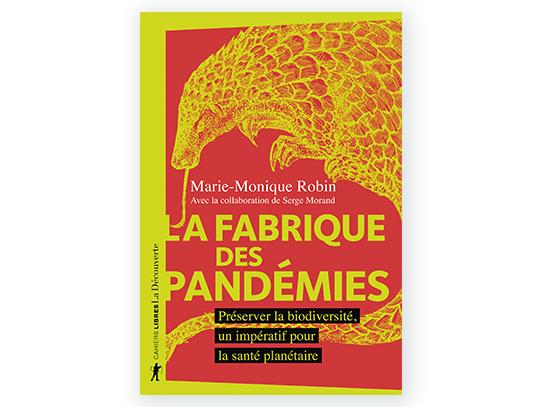Grippe : et si l’on parlait prévention ?
(Seconde partie)

En médecine énergétique, on dit que l’automne prépare l’hiver. Si vous voulez passer un hiver sans grippe, n’attendez donc pas plus longtemps pour vous préoccuper de prévention. Avec cet article, dans lequel je présente les trois préceptes clés à retenir en matière d’immunité, je vous donne l’occasion de passer dès maintenant aux travaux pratiques !
Le premier aspect abordé est celui de l’énergie
Car, à l’évidence, la fatigue a des répercussions sur notre résistance aux infections. Les personnes atteintes d’herpès connaissent bien la musique : un peu trop de stress, la fatigue qui s’installe, et hop, le virus se « réveille », et c’est la crise ! Vers la fin des années 70, une étude réalisée auprès de personnes grippées avait montré que des situations stressantes provoquaient une dépression immunitaire deux ou trois jours avant de tomber malade.
Précepte n° 1 :
Pas de bonne immunité sans un bon niveau d’énergie
Le maintien d’un bon niveau d’énergie dépend nécessairement du bon fonctionnement de la multitude de mitochondries présentes dans chacune de nos cellules. Les mitochondries sont de minuscules structures spécialisées qui produisent de l’énergie au terme d’une série complexe de réactions chimiques nécessitant la présence d’oxygène et de nutriments. Le produit final obtenu est une molécule d’énergie appelée adénosine triphosphate ou ATP, pour faire plus court.
Preuve que les cellules de notre organisme dépendent énormément de l’ATP pour assurer leur fonctionnement, les mitochondries en fabriquent environ 40 kg par jour ! Si, si, vous avez bien lu… Dans ces conditions, on comprend de suite la nécessité de fournir aux mitochondries les matières premières dont elles ont besoin pour accomplir leur travail de forçat.
D’abord, honneur à l’oxygène, notre aliment le plus vital car, sans lui, notre espérance de vie ne dépasse guère quelques minutes ! Pour assurer à l’organisme un bon apport en oxygène, faites en sorte de maintenir un bon niveau de dépense physique et de pratiquer au quotidien la respiration consciente (respiration profonde par le ventre avec un temps d’expiration au moins deux fois plus long que le temps d’inspiration). Des recommandations d’autant plus valables en hiver, où les conditions météorologiques nous incitent à moins bouger et à rester confiné dans des lieux clos. Pensez à bien aérer votre logement au cours de cette période !
Parmi les nutriments impliqués dans la fabrication de l’ATP, mention spéciale au magnésium, surnommé le « minéral de l’énergie ». Les mitochondries contiennent à elles seules un tiers du magnésium cellulaire. Un déficit marqué en magnésium se traduit par une sensation de faiblesse, des coups de pompe fréquents et une moindre résistance aux stress. Or, la déficience en magnésium est devenue chose courante, compte tenu de l’appauvrissement des aliments en magnésium et du stress généré par le mode de vie actuel qui occasionnent une fuite urinaire importante de magnésium. Il ne faut donc pas hésiter pas à envisager une complémentation régulière.
Quel magnésium choisir ?
- Les partisans du naturel s’orienteront vers un magnésium d’origine végétale ou marine.
- Sinon, parmi les formes chimiques de magnésium, celle qui possède les meilleures propriétés énergétiques est le malate de magnésium, combinaison d’acide malique et de magnésium. L’acide malique est un composé organique dont la mitochondrie a besoin pour produire de l’énergie. Le malate de magnésium est très conseillé aux personnes souffrant d’un syndrome de fatigue chronique. La meilleure source alimentaire en acide malique est la pomme.
Impossible de ne pas consacrer quelques lignes à la coenzyme Q10, qualifiée à juste titre de nutriment « anti-âge » et « antifatigue », que l’on conseillera en priorité aux seniors. La coenzyme Q10 joue un rôle crucial dans la production d’énergie, sauf qu’avec l’âge, le niveau intracellulaire de coenzyme Q10 diminue inexorablement, d’où une baisse du rendement énergétique des mitochondries se traduisant par une sensation de fatigue et un manque d’endurance. Des expériences ont montré qu’en ajoutant de la coenzyme Q10 à des mitochondries âgées, leur fonctionnement s’améliorait et la production d’énergie augmentait.
Privilégiez la forme non oxydée de coenzyme Q10 (ubiquinol), bien mieux assimilable que la forme oxydée (ubiquinone).
Précepte n° 2 :
Pas de bonne immunité sans un intestin en bon état
L’intestin est un organe immunitaire de très grande importance, ne serait-ce que parce qu’il concentre à lui seul 70 % des cellules immunitaires de l’organisme ! Parler d’intestin est à vrai dire un peu réducteur. Il convient plutôt d’évoquer l’écosystème intestinal pour bien signifier qu’il s’agit d’un monde en soi.
Cet écosystème intestinal est constitué de 3 éléments qui interagissent les uns avec les autres : le microbiote (anciennement « flore intestinale »), la muqueuse intestinale et le système immunitaire intestinal.
Tout ce qui est susceptible de perturber l’équilibre du microbiote, de menacer l’intégrité de la muqueuse intestinale et de conduire à une stimulation excessive des défenses immunitaires locales, peut constituer la cause cachée de nombreux problèmes de santé (intolérances alimentaires, phénomènes allergiques, infections à répétitions…).
Dès la naissance, notre intestin est colonisé par plus de 500 espèces bactériennes « amies » qui vont former le microbiote. Un microbiote appelé à devenir un acteur clé de notre santé car il va non seulement s’opposer localement à la prolifération de bactéries pathogènes, mais également contribuer, par diverses voies, au renforcement du système immunitaire.
L’équilibre du microbiote peut être grandement altéré sous l’influence de différents facteurs tels qu’une alimentation déséquilibrée et dénaturée, un stress psychologique prolongé et des traitements antibiotiques répétés, surtout dès le plus jeune âge. Il en résulte une « dysbiose intestinale » à l’origine de possibles troubles à distance, en particulier de troubles infectieux affectant notamment la sphère urinaire (cystites) ou respiratoire (bronchiolites, pneumopathies…).
- Les probiotiques sont des compléments alimentaires à base de bactéries « amies » qui aident à rééquilibrer le microbiote, à réparer la muqueuse intestinale et à soutenir l’immunité, tantôt en la stimulant, tantôt en la « calmant ». Ils peuvent se monter éminemment utiles pour prévenir les infections de la sphère O.R.L. liées à un dérèglement de l’écosystème intestinal.
Des résultats d’études sont là pour en témoigner.
« Une nouvelle possibilité de prévenir les pathologies hivernales par l’administration de symbiotiques« , tel est le titre d’une étude clinique de 2008 dans le cadre de laquelle ont été administrés plusieurs hivers durant, des « symbiotiques », c’est-à-dire un mélange de probiotiques (3 à 5 souches différentes) et de prébiotiques (des composés que l’on trouve naturellement dans les fruits et les légumes sous forme de fibres solubles non digestibles). Les résultats obtenus démontrent « qu’un apport régulier et de longue durée en symbiotiques peut améliorer la santé en réduisant la fréquence et la sévérité des pathologies respiratoires au cours de la saison froide » (1).
En 2009, une autre équipe de chercheurs a voulu vérifier l’efficacité des probiotiques sur l’incidence et la durée des refroidissements et syndromes grippaux chez les enfants âgés de 3 à 5 ans, et il s’est avéré « qu’un apport quotidien en probiotiques pendant 6 mois suffisait pour réduire la fièvre, l’écoulement de liquide par le nez (rhinorrhée), la fréquence et la durée de la toux, et la fréquence de prescription d’antibiotiques » ( 2).
D’autres études récentes ont également mis en évidence que certains probiotiques sont capables de potentialiser la réponse immunitaire au vaccin contre la grippe saisonnière, en particulier Lactobacillus GG et Lactobacillus fermentum.
- En pratique, choisir un probiotique « généraliste » contenant une large sélection de souches de lactobacilles et bifidobactéries. En raison de leur rôle majeur dans l’équilibre de l’écosystème intestinal, s’assurer que Lactobacillus acidophilus, casei et rhamnosus figurent bien dans la formule du produit.
Précepte n° 3 :
Pas de bonne immunité sans un bon taux de vitamine D
Je ne m’étendrai pas longuement sur ce 3e précepte parce que cela fait déjà des années que je rappelle régulièrement aux lecteurs de Rebelle-Santé le rôle crucial que joue la vitamine D dans le domaine de l’immunité, notamment en stimulant la synthèse de notre « antibiotique » naturel : la cathélicidine.
On considère qu’un taux de vitamine D de 30 à 40 ng/ml est requis pour une activation optimale de la cathélicidine.
Très récemment, des chercheurs ont publié une étude sur le lien entre statut en vitamine D et fréquence de survenue d’infections respiratoires aiguës. Plus de 14 000 sujets ont été inclus dans cette étude.
Résultat : plus le taux de vitamine D s’éloignait de la zone de carence (< 10 ng/ml) pour atteindre une valeur convenable (> 30 ng/ml), plus le risque d’infection diminuait (3) !
Il y a quelques années, deux études cliniques ont établi que la vitamine D pouvait contribuer à prévenir la grippe saisonnière (4). Dans l’une, on a donné 1200 UI/jour à des enfants et adolescents et dans l’autre, conduite auprès de sujets adultes, les meilleurs résultats ont été obtenus avec un apport quotidien de 2000 UI/jour. Mais rien n’empêche, chez les adultes, de doubler cette dose pendant plusieurs mois afin d’optimiser le taux de vitamine D dans les meilleurs délais. Privilégier la vitamine D3 sous forme huileuse (avec goutte dosée à 400 UI).
Dernière précision : plus l’apport oral quotidien en vitamine D est important, plus il devient souhaitable de se supplémenter parallèlement en magnésium, car le métabolisme de la vitamine D nécessite la présence de magnésium.
Décidément incontournable, ce cher magnésium !
Notes :
(1) Pregliasco F., J Clin Gastroenterol, 2008 Sep
(2) Leyer GJ., Pediatrics, 2009 Aug
(3) Monlezun DJ., Nutrients, 2015 Mar
(4) Urashima M., Am J of Clin Nutr, 2010 Mar ; Aloia J., Epidemiology, 2007