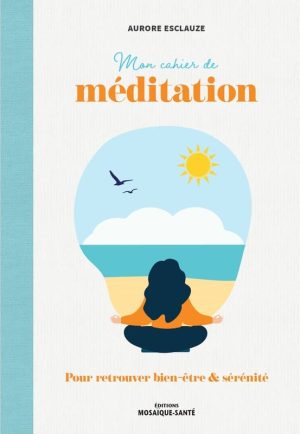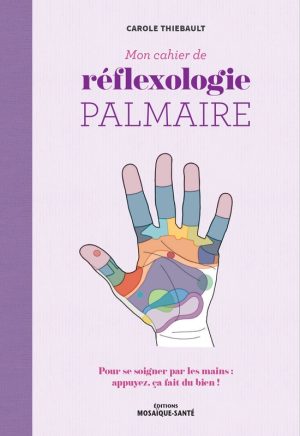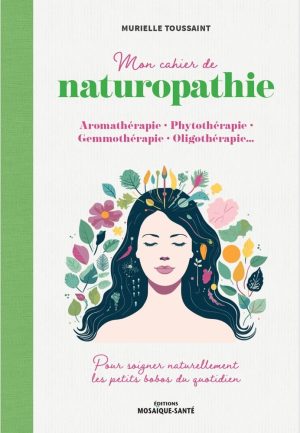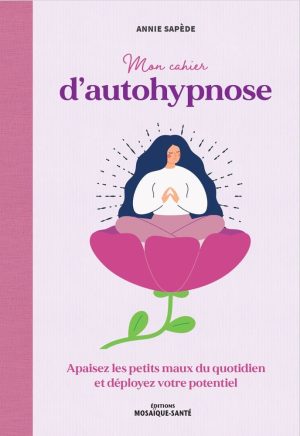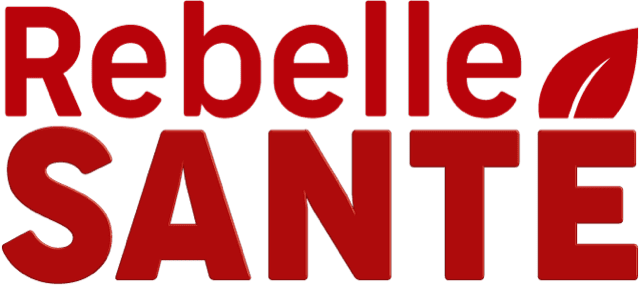En route vers le futur, sur la piste du projet d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure
Quelques jours de marche avec Étienne Davodeau pour penser le nucléaire à l’échelle de l’histoire de l’humanité.
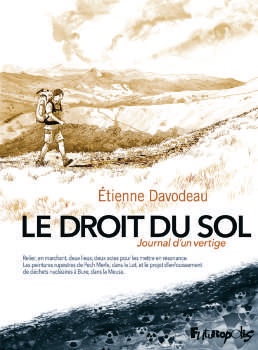
Que faire des déchets nucléaires qui s'accumulent et dont certains resteront actifs et dangereux pendant des milliers d'années ? L'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, propose tout simplement de les enfouir. Bientôt, l'usine Orano de la Hague, dans le Cotentin, qui s'occupe des déchets les plus dangereux, arrivera à saturation. C'est pour trouver un autre débouché qu'est né le projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique) à Bure, dans la Meuse, afin de les enterrer à 500 mètres de profondeur.
À 56 ans, Étienne Davodeau est un auteur réputé pour ses bandes dessinées documentaires. Il y a dix ans, il signait Les Ignorants, un chef-d’œuvre du genre, le récit d’une initiation croisée où il apprenait l’art de cultiver la vigne dans le respect de la terre auprès de Richard Leroy, un vigneron de l’Anjou. Notre rapport à la nature est aussi au cœur de Le Droit du sol*, ce nouvel album d’abord conçu comme le journal d’une marche, entreprise par l’artiste en juin 2019 pour relier les 800 kilomètres qui séparent la grotte de Pech Merle, dans le Lot, au projet de site d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Pas à pas, ce “journal d’un vertige” donne la mesure du temps qui nous lie, nous les Homo sapiens, depuis la préhistoire, avant que le sol ne se dérobe sous nos pieds, face au fardeau que nous nous apprêtons à léguer aux générations futures.
Rebelle-Santé : Le laboratoire de Bure est une drôle de destination pour une randonnée. Qu’est-ce qui vous a décidé à partir sur la piste des déchets nucléaires ?
Étienne Davodeau : On dit souvent que “l’industrie nucléaire, c’est un appartement sans toilettes”. La question des déchets conditionne l’existence même de cette industrie parce qu’on ne sait pas quoi en faire. En tant que citoyen, je me sens concerné par les problématiques écologiques que pose le nucléaire, et je soutiens le réseau “Sortir du nucléaire” depuis les années 1990. Et même si en Anjou, je vis dans une des rares régions françaises où il n’y a pas de centrale, les matins d’hiver quand il fait beau, je peux voir de la fenêtre de ma chambre les nuages de celle de Chinon qui se situe à 85 kilomètres de ma maison. Ces vapeurs sont comme une piqûre de rappel pour me dire que même si c’est loin, que je le veuille ou non, je profite aussi de cette énergie délirante. En France, 70 % de notre électricité provient des centrales nucléaires. Pourtant, à l’échelle de l’électricité produite dans le monde, la part du nucléaire est dérisoire.
À l’issue de la COP26, le nucléaire a connu un retour en grâce, apparaissant pour certains comme une solution décarbonnée pour la production d’énergie.
Oui, c’est comme si l’industrie nucléaire jouait là sa toute dernière carte. Depuis les catastrophes comme Tchernobyl et Fukushima, l’opinion est tout à fait consciente du danger et je crois que personne en France n’est totalement partisan du nucléaire.
En revanche, la grande majorité des gens veulent une électricité abondante et bon marché et, pour ça, ils sont prêts à oublier les inconvénients et les risques. On consomme le nucléaire un peu comme des toxicomanes, nous sommes en état de réelle dépendance. Nous vivons dans le pays de très loin le plus nucléarisé du monde. Tous les présidents de la Cinquième République depuis De Gaulle ont été des promoteurs zélés de cette industrie au point qu’elle nous paraît inévitable. Or, cette politique n’a jamais été l’objet du moindre débat, ni à l’échelle de la population, ni à l’Assemblée, ce qui me semble tout à fait scandaleux.
Pourquoi choisir de relier les peintures de la grotte de Pech Merle, peintes il y a plus de 20 000 ans, à ce projet d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure ?
J’ai découvert la grotte de Pech Merle à l’occasion d’un projet collectif, Rupestres !, initié par le dessinateur David Prudhomme. Mon point de départ, c’est ce mammouth dessiné par un Homo sapiens il y a 22 000 ans. Ce dessin est d’une modernité sidérante. Je suis bluffé par la puissance graphique et la puissance inaltérable de cette image. Pour moi qui passe mes journées à dessiner, là où il y a humanité, il y a dessin. Le parallèle avec Bure est venu naturellement, comme une évidence. À Pech Merle comme à Bure, ce sont des Sapiens qui laissent des choses sous terre. Sauf qu’à Pech Merle, les traces sont belles, inoffensives, et on peut encore les admirer, tandis qu’à Bure, nous nous apprêtons à enterrer lâchement des déchets nocifs pour des centaines de milliers d’années, après avoir profité de façon très éphémère – et finalement très égoïste – de leur électricité. Les générations futures auront à gérer ces endroits dangereux au nom de notre petit confort, sans même en avoir bénéficié. J’ai donc cherché le moyen de mettre physiquement en résonance ces deux perspectives diamétralement opposées. Et le moyen le plus simple, c’est de marcher, parce que c’est aussi la condition commune que nous partageons avec les Sapiens de la préhistoire, et sans doute avec celles et ceux du futur.
Vous marchez, mais le vertige dont vous voulez faire prendre conscience est d’abord une prise de conscience temporelle ?
Quand on parle en centaines de milliers d’années, il est impossible de concevoir le nombre de générations, de civilisations, de drames et de progrès successifs que ça englobe. En considérant ces dates, le vertige permet de prendre conscience à la fois de notre finitude, de la brièveté de nos existences, mais aussi de faire l’expérience de l’impact de l’Homo sapiens sur terre, de la validité et de la durabilité de certains de ses actes, qu’ils soient positifs ou négatifs, conséquents ou dérisoires. La personne qui a dessiné ce mammouth à Pech Merle il y a 22 000 ans n’avait aucune idée de la façon dont son dessin allait lui survivre et de la façon dont il allait être vu. Mais la manière dont je le vois me fait ressentir une forme de solidarité qui existe entre les Sapiens. Eux, c’est nous. Et pour moi, cette solidarité doit s’étendre sur les centaines de milliers d’années à venir. Il est impossible de se projeter pour savoir qui habitera à Bure dans aussi longtemps, mais s’il y a des gens là-bas, ils devront faire attention à ce qu’on leur aura laissé.
La question de la transmission est au cœur de votre questionnement. Il y a ce passage où vous évaluez la durabilité de votre livre avec une historienne spécialiste du papier et celui où vous réfléchissez avec une sémiologue pour savoir comment indiquer le site de Bure dans la durée.
Comment signaler aux Homo sapiens qui vivront dans 100 000 ans, le colis piégé qu’on leur a laissé sous la terre ? Sauront-ils déchiffrer notre écriture ? Quelle langue ? Le français est une langue vivante, donc mortelle, qui aura totalement disparu bien avant cent mille ans. Quel signe faut-il inventer pour faire passer ce message ?
Toutes ces questions sont, elles aussi, vertigineuses. Et en m’entretenant avec la sémiologue Valérie Brunetière, il apparaît que le signe le plus efficace passe sans doute par le dessin, si bien que lorsque, comme moi, on est en train de réaliser un livre de bande dessinée sur ces questions de transmission, une espèce de cercle s’autoalimente de façon assez fascinante. Le mammouth de Pech Merle revient alors immédiatement à l’esprit, comme un signal évident.
Cet album, c’est le journal d’une marche mais aussi l’exposé d’une démarche, un récit recomposé à votre retour dans votre atelier. Il est ainsi jalonné de rencontres avec des personnes qui éclairent le parcours. Comment l’avez-vous pensé ?
J’aime marcher et je l’ai toujours fait. La différence, c’est que cette fois-ci je marchais pour faire un livre. Ce qui était aussi très nouveau pour moi.
Pour concevoir un livre, on commence d’habitude en écrivant un scénario. Ici, la première étape a consisté à remplir mon sac à dos et à mettre un pied devant l’autre. Tout s’est entremêlé. Je savais d’emblée que ce serait comme un journal, mais j’avais aussi décidé que ce ne serait pas seulement un compte-rendu sensible d’une marche au long cours, que j’enrichirais aussi cette marche de témoignages divers. J’en avais emmagasiné certains avant de partir, d’autres sont venus ensuite.
L’avantage de marcher pendant des semaines, c’est qu’on a le temps de réfléchir à ce qu’on va faire, et le livre s’est véritablement constitué dans mon cerveau en marchant, bien que je n’aie pas dessiné pendant des semaines. Ce qui est aussi très exceptionnel. Je n’ai rapporté que des photos et des notes que je prenais chaque soir au bivouac. J’ai commencé à dessiner en rentrant, de façon chronologique de la première à la dernière page. Pendant deux ans, j’ai refait la balade mais de manière extrêmement lente, diluée, en prenant le temps, trait après trait, de revivre le vertige de tous ces questionnements.
En France, au niveau juridique, le Droit du sol permet d’obtenir la nationalité française quand on naît sur le sol français. Vous détournez cette appellation pour définir un autre rapport à la planète. Comment doit-on lire ce titre ?
Le droit à la nationalité est un droit qu’on a sur le sol. Dans ma proposition, c’est l’inverse, c’est le droit qu’il faudrait donner au sol. D’un point de vue politique, alors que la campagne électorale fait rage, et que certains remettent en question le droit du sol, dans ce contexte des crispations autour du sempiternel débat identitaire, c’est une manière de rappeler que les Homo sapiens migrent depuis la préhistoire. Ils se déplacent à la surface du sol, simplement pour trouver un endroit où vivre dignement. Et les migrants d’aujourd’hui ont les mêmes droits que ceux d’hier, la terre ne nous appartient pas. En revanche, comme le dit si bien Marc Dufumier, cet ingénieur agronome et pédologue (spécialiste de la biologie des sols) : “Pas de sol, pas de Sapiens“. Quand on saccage les sols, on se saccage soi-même. C’est le droit du sol que je revendique. Je m’intéresse par ailleurs beaucoup aux travaux du Parlement de Loire, dans la lignée des décisions prises en Nouvelle-Zélande, où on envisage de donner une personnalité juridique à un fleuve. Il ne s’agit pas de donner un droit au sol contre nous, mais de considérer qu’en donnant des droits à la nature, on se protège et on prend soin de nous-mêmes.
“L’Homme est la nature qui prend conscience d’elle-même”, cette citation d’Élisée Reclus est placée en exergue. Dans votre livre, vous dites que la marche permet de “s’immerger à la surface du sol”. Comment ?
“S’immerger à la surface du sol”, d’un point de vue syntaxique, ça ne tient pas debout mais d’un point de vue plus général, c’est très bénéfique. Comme un appel à se reconnecter à la nature, à retrouver la conscience qu’avait sans doute la personne qui a dessiné son mammouth à Pech Merle. Ce lien-là s’est perdu. Nous sommes désormais majoritairement des urbains assis, parfois même si nous vivons à la campagne. Le monde capitaliste a réduit le sol a une surface qu’on exploite, d’où l’on extrait des ressources. La marche est un moyen d’expérimenter ce lien à la nature de manière concrète et indiscutable parce que c’est quelque chose de physique, de physiologique qui passe par le corps. J’invite ainsi les gens à aller se balader, à vivre dehors quelques jours, à dormir à la belle étoile. Il n’y a pas besoin de partir loin, il suffit de prendre un petit sac et de sortir de chez soi.
Plus on s’approche de Bure, plus la tension monte. Vous parlez d'”un territoire en lutte”, l’objectif de la balade est-il de montrer ce qui se passe là-bas ?
Absolument. Je veux que les gens prennent connaissance du projet Cigéo, tout simplement parce que quand on se lève le matin en France et qu’on allume la lumière ou sa machine à café, on génère des déchets nucléaires. Au départ de ma balade, dans le Lot, les gens que je rencontrais n’avaient aucune idée de ce projet d’enfouissement qui est encore assez mal connu, et c’est aussi une des raisons qui m’ont poussé à faire ce livre. L’ignorance s’estompait au fur et à mesure que je me rapprochais de la région. Les derniers jours, plus j’approchais, plus ça devenait un sujet tabou et clivant. Là-bas, les gens sont, soit tout à fait pour parce qu’ils y voient des bénéfices économiques, soit tout à fait contre. L’ANDRA a choisi ce lieu parce que c’est un des endroits les moins peuplés du pays. Dans les décennies précédentes, ailleurs en France, ce type de projet a rapidement avorté sous la pression des populations.
Mais ce que l’État n’avait pas prévu, c’est que d’une part, même s’ils ne sont pas nombreux, ces gens qui vivent sur ce territoire ont les mêmes droits que les autres. Et d’autre part, d’autres personnes, à cause de ce projet mortifère, sont venues s’installer à Bure et dans les villages autour pour s’y opposer. Bure est ainsi devenu un lieu très novateur sur cet autre point : ce qui s’y invente en termes de résistance citoyenne et de luttes sociales est très intéressant.
Vous prenez clairement le parti des opposants au projet en refusant de donner la parole aux partisans et à l’ANDRA, pourquoi ?
C’est un récit subjectif. Personnellement, je ne suis pas journaliste. Le projet Cigéo bénéficie sur place de l’action de la gendarmerie et de la justice. L’ANDRA injecte aussi des millions d’euros chaque année sur le territoire pour faire accepter son projet. Et ce n’est pas moi qui juge de la sévérité des sanctions dont sont victimes les militants, c’est la Ligue Internationale des Droits de l’Homme qui a publié deux rapports sur les décisions prises par le tribunal de Bar-le-Duc en 2019 et dont je fournis les liens à la fin de mon livre. Ces militants sont traités comme des associations de malfaiteurs. Face au déséquilibre des forces en présence avec d’un côté l’État, l’argent, la gendarmerie et la justice, de l’autre des gens qui n’ont rien d’autre que leur détermination et leur sens de l’intérêt commun, des gens qui n’ont rien à gagner à titre personnel, sinon ces sanctions démesurées, je décide de ne pas entériner ce déséquilibre. Je donne la parole à ceux dont je pense qu’ils ne l’ont pas assez, et pour qui j’ai le plus profond respect.
À la fin de la balade, vous allez poser votre sac au bois Lejuc, le lieu précis prévu par l’ANDRA pour le projet Cigéo. Vous écrivez “Ce bois, c’est là où nous vivons”, de quoi ce bois est-il le symbole ?
La fin d’un livre, c’est l’ultime sensation qui reste d’une lecture. C’est quelque chose à laquelle j’accorde énormément d’importance. Après deux cents planches à marcher à mes côtés en se questionnant sur tous ces sujets, comment rester positif et ouvert, sans pour autant s’illusionner avec de faux espoirs. Le bois Lejuc est une petite forêt anodine, de quelques hectares, qui n’aurait aucune raison d’être connue si elle n’était pas menacée par le projet Cigéo. C’était aussi la destination de mon voyage et j’ai voulu donner à ce bois toute l’importance qu’il a. Le jour où le bois Lejuc sera rasé sera important pour nous tous. Ce serait formidable que ça n’arrive pas. Pour l’instant, c’est juste un bois et il peut synthétiser tout ce qui se passe là-bas, prendre en charge dans ses branchages toutes ces questions qui restent valides tant qu’il existe. Il est le symbole d’une lutte qui continue. Les galeries de l’ANDRA ne sont pas encore construites. Le projet Cigéo peut encore s’arrêter. Les recours seront innombrables. Rien n’est joué.
___
*Le Droit du sol, Journal d’un vertige, Étienne Davodeau – Éditions Futuropolis – 216 pages – 20 x 27 cm – 25 € (eBook : 17,99 €).
Pour lire la suite
Avec Rebelle-Santé, découvrez les bienfaits de la santé naturelle et des médecines douces ! Notre magazine est totalement indépendant, chaque article est soigneusement rédigé (par des humains) dans votre intérêt exclusif. Aucune publicité déguisée. En vous abonnant, vous aurez accès à plus de 10 000 articles et 45 nouveaux articles chaque mois.
Déjà abonné·e, connectez-vous !