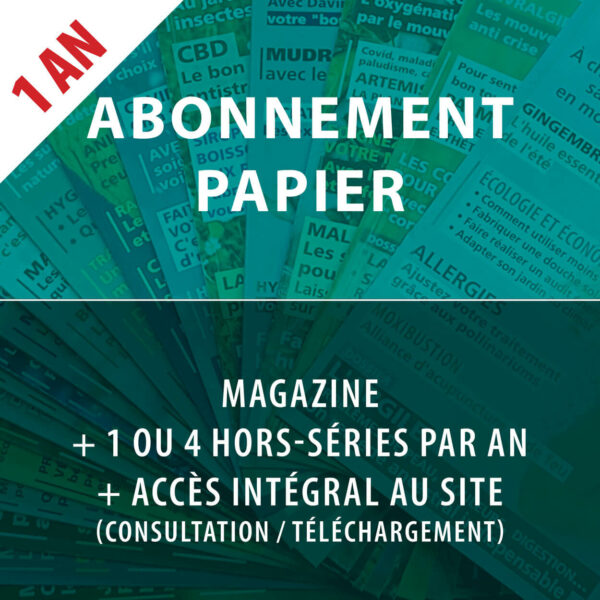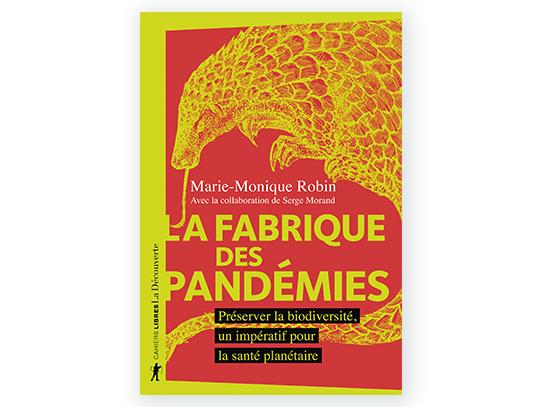La trichotillomanie, une maladie à s’arracher les cheveux

Quoi de plus machinal que de tortiller une mèche de cheveux entre ses doigts ? Mais tout change lorsque ce tic a pour but de s’arracher les cheveux volontairement.
Il y a bien longtemps que personne ne se retourne plus dans la rue sur un homme jeune chauve, que ce soit naturel par perte des cheveux (calvitie) ou par rasage, à l’instar des personnalités du sport, de la télévision ou de la chanson française. Mieux, la « chauvitude » est désormais tendance et synonyme de virilité auprès des hommes qui ne se précipitent plus systématiquement chez le perruquier pour retrouver leur chevelure d’antan.
La chevelure, un symbole fort chez les femmes
En revanche, chez les femmes, importance symbolique de la chevelure oblige, l’alopécie* s’avère inquiétante et génère souvent des interrogations, voire une réelle inquiétude teintée de malaise pour l’entourage ou la personne elle-même : s’agit-il d’une maladie (cancer, champignon…) ? D’un stress (mais lequel ?) ? D’une calvitie volontaire par rasage (se raser d’accord, mais c’est inhabituel quand on est une femme ?) ? Des conséquences d’un traitement (chimiothérapie anticancéreuse ?) ? Il reste aussi un autre diagnostic, sous-évalué : la trichotillomanie, autrement dit un arrachage volontaire d’origine psychologique. Une pathologie, spectaculaire chez la femme adulte, mais qui n’épargne pas l’enfant ou l’adolescent. Si les cheveux demeurent les phanères (poils, sourcils, cils, cheveux, barbe, moustache…) les plus prisés par les trichotillomanes, car pratiques à arracher, certains s’arrachent aussi les poils pubiens, les sourcils et même les cils.
Un trouble obsessionnel d’origine génétique ?
Cette habitude irrépressible, qui commence souvent dès la puberté, est considérée par certains psychiatres comme étant un trouble obsessionnel compulsif (TOC) et, par d’autres, comme une addiction comportementale du fait du plaisir ressenti lors de l’acte. Les trichotillomanes consultent peu, et lorsque c’est le cas, ils consultent plutôt les dermatologues que les psychiatres. Faute de consultation, il est donc difficile d’en connaître la fréquence exacte, d’autant que la trichotillomanie n’est parfois que l’un des symptômes d’une autre pathologie psychiatrique sous-jacente (dépression, névrose, psychose…). Pour autant, on estime qu’un adulte sur 200 serait concerné. Aux États-Unis, les statistiques avancent 2 millions de patients. 90 % des trichotillomanes seraient des femmes et les enfants seraient très souvent concernés (arrachage de leurs propres cheveux, ceux des autres ou des poils de leurs animaux de compagnie). Selon une étude américaine pratiquée sur 44 familles de trichotillomanes, et qu’il reste encore à vérifier, cette pathologie serait d’origine génétique et liée à deux mutations (R584K et S593G).
Prise en charge
La prise en charge de la trichotillomanie n’est pas facile et les traitements, médicamenteux – anxiolytiques, clomipramine, sertraline, ISRS… – ou comportementaux, pas toujours efficaces, et ce d’autant que la personne peut être en déni de son problème psychologique. La prise en charge comporte un suivi par un psychiatre (importance du dialogue, de la prise de conscience par le malade, travail sur l’estime et l’affirmation de soi, relaxation…) et vise notamment à amener le trichotillomane à éviter l’arrachage compulsif des phanères lors des situations anxiogènes ou stressantes (intérêt des thérapies cognitivo-comportementales) et à réduire le plaisir lié à l’arrachage en lui opposant les conséquences négatives du geste (bénéfices de l’arrêt). Quant à la trichotillomanie de l’enfant, elle est moins problématique et souvent le fait d’un conflit ou d’un souci familial. Un entretien avec l’enfant visant à le rassurer peut suffire à le guérir.
Autre perte de cheveux pathologique
Teigne : infection du cuir chevelu par un champignon microscopique (dermatophyte), avec la présence de squames dans la zone concernée et la positivité du test lors de la recherche du champignon.
Pelade : origine encore mal connue (mécanisme auto-immun, stress…?) avec des cheveux fragiles qui ne tiennent pas bien dans le cuir chevelu et donc, tombent naturellement. La pelade se manifeste par plaques le plus souvent.
* L’alopécie désigne la chute ou l’absence des cheveux ou des poils, partielle ou généralisée, sans préjuger de son origine.