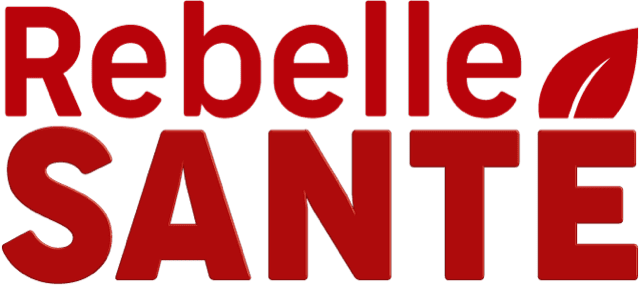Parlons de la grossophobie
Une discrimination invisible...

Les goûts se construisent socialement. Les concepts de beauté évoluent aussi selon les contextes historiques, se contredisant parfois. Regardez ces deux amoureux de Jacob van Loo… "Couple d'amoureux, 1650"Ils reflètent l’idéal de beauté du XVIIe siècle.
Dans le pays où j’ai grandi, mais aussi dans tout l’Orient, on aime la rondeur naturelle. Sans doute influencée par ce contexte, j’ai toujours apprécié d’être un peu ronde, tout en essayant de garder de la légèreté, de ne pas être en « surpoids », ne serait-ce que pour ma santé. Et ce n’est pas facile.
Heureusement, j’ai la chance de pouvoir manger sain et bouger dans la nature. Mais est-ce le cas de tout le monde ? Qu’en est-il de celles et ceux qui ont des conditions de vie plus difficiles ? Je ne parle pas des plus pauvres, mais simplement des « travailleurs de classe moyenne », ces personnes qui vivent en ville, qui ont une famille, une maison ou une voiture à rembourser, et tant de choses à faire chaque jour…
Facteurs sociaux de l’obésité
On ne naît pas obèse, on le devient. Mais qui grossit ainsi ? L’obésité est deux fois plus répandue dans les catégories sociales les moins favorisées (16,7 % chez les ouvriers, 16,2 % chez les employés) que dans les catégories plus aisées (8,7 % chez les cadres supérieurs)¹.
Entre 2000 et 2012, la part des adultes obèses de plus de 18 ans a progressé de 4,9 points, passant de 10,1 à 15 %, soit près de 7 millions de personnes touchées en 2012. Presqu’un adulte sur deux touché par l’obésité vit avec des revenus inférieurs à 1200 € mensuels contre 7 % de ceux qui gagnent plus de 5300 € par mois. Il est parfois très difficile de mincir, même en faisant beaucoup d’efforts et même en sachant combien le surpoids est facteur d’ennuis de santé… Et, en plus, quand on a des kilos en trop, on est souvent bien mal traité. À cause des canons actuels de la beauté, qui nous obligent à être mince… Ne serait-ce que pour avoir accès à un large choix de vêtements. L’obésité est source de discrimination, même s’il s’agit souvent d’une discrimination invisible.
La grossophobie
Pour preuve que la discrimination envers les gros est invisible, le mot « grossophobie » n’existe pas dans les dictionnaires ordinaires. En écrivant cet article, maintenant, mon ordinateur me signale une faute : il souligne en rouge le mot « grossophobie ». C’est incroyable : l’une des discriminations les plus répandues n’a pas de nom. Le niveau de cette discrimination va jusqu’à sa non-reconnaissance, jusqu’à un certain déni de fait. Alors, je la rends visible au moins sur mon ordinateur : je clique sur « ajoutez au dictionnaire ». Il faut le faire, mais pas uniquement sur nos ordinateurs, faisons-le dans tous les espaces de discrimination.
Jusqu’à cette année, ce mot n’existait pas dans la langue française telle qu’elle est validée par l’Académie. Cependant, il y a eu un premier pas, symbolique mais important : en 2019, Le Petit Robert va définir la grossophobie comme une « attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids ».
Et dans le domaine de la santé ?
Dans le réseau du collectif Gras Politique, on parle souvent de la « grossophobie médicale ». Les personnes en surpoids racontent des histoires terribles. Les victimes de ces discriminations sont conseillées et encouragées à se défendre : « Ne te culpabilise pas, un.e médecin doit savoir recevoir, soigner tous et toutes les patient.es, de manière objective, c’est son métier, c’est la loi. »
Oui, c’est la loi. L’article L. 1110-2 de la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades dit que toute personne malade a droit au respect de sa dignité.
Soyons plus attentifs à la grossophobie et parlons-en… pour contribuer à sa disparition.
Article R4127-7 du Code de la Santé Publique « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. » |
Notes :
¹ – Étude ObÉpi « Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l’obésité 2012 ».
Pour lire la suite
Avec Rebelle-Santé, découvrez les bienfaits de la santé naturelle et des médecines douces ! Notre magazine est totalement indépendant, chaque article est soigneusement rédigé (par des humains) dans votre intérêt exclusif. Aucune publicité déguisée. En vous abonnant, vous aurez accès à plus de 10 000 articles et 45 nouveaux articles chaque mois.
Déjà abonné·e, connectez-vous !