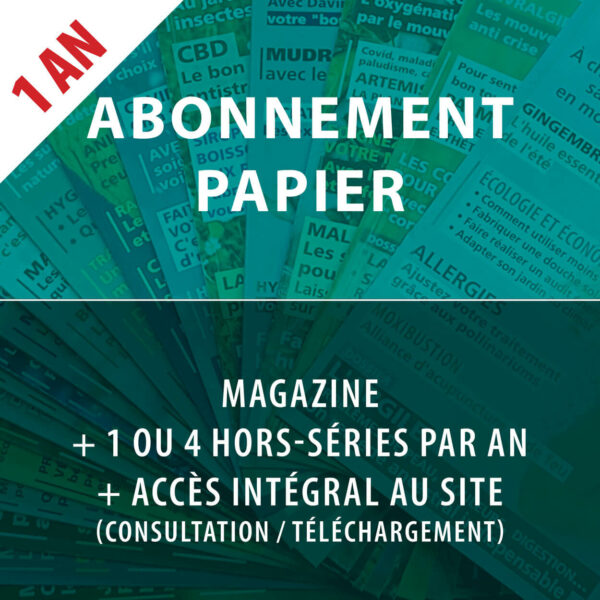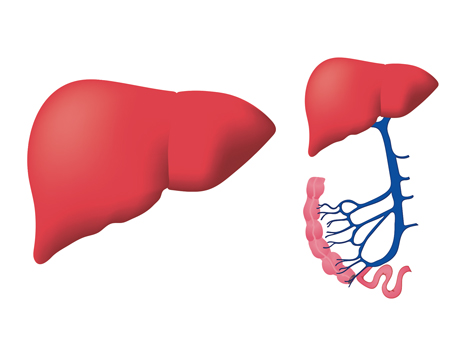Maladie du « foie gras », et si nous manquions d’amibes ?
Le nombre de cas de stéatose hépatique, ou maladie du « foie gras », a explosé ces dernières années. Difficile de ne pas tenir compte de l’alimentation riche en gras et en sucre, et plus largement de notre mode de vie occidental comme facteur n° 1 de cette maladie. Cependant, d’autres causes peuvent s’y associer et Jean-Pierre Hugot, chercheur au sein d’une équipe Inserm du Centre de recherche sur l’inflammation à Paris, s’est intéressé au rôle potentiel des amibes. Ces parasites intestinaux ont quasiment disparu en Occident. Or, si elles ont mauvaise réputation car certaines d’entre elles sont responsables de désordres (diarrhées), la plupart sont, au contraire, inoffensives. Pour Jean-Pierre Hugot, « si des amibes ont longtemps colonisé nos intestins, c’est probablement qu’il existe une certaine symbiose entre elles et nous. Ainsi, peut-être qu’avec leur disparition nous perdons un avantage ? ». Les chercheurs ont donc inoculé des amibes à des souris et se sont aperçus que les « amibes rééquilibrent la flore intestinale altérée par le régime riche en gras » et le risque de stéatose hépatique diminue. Une piste à suivre…