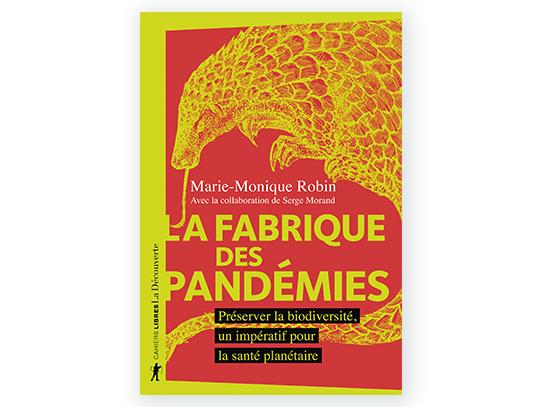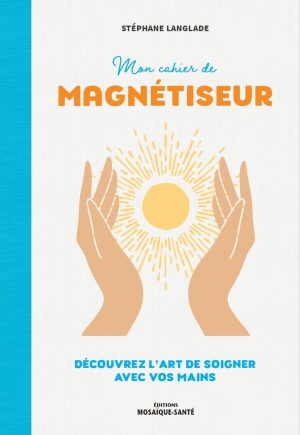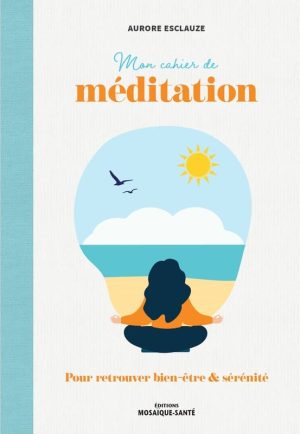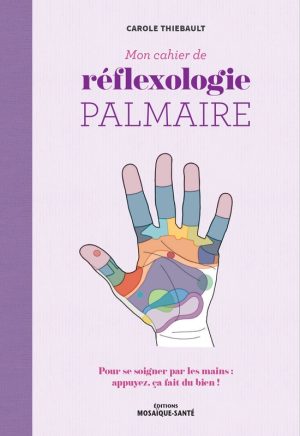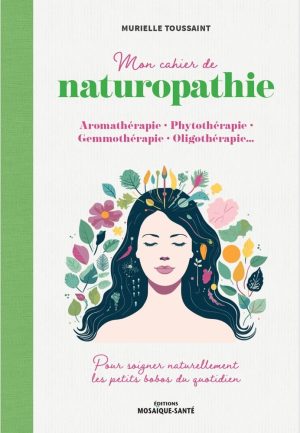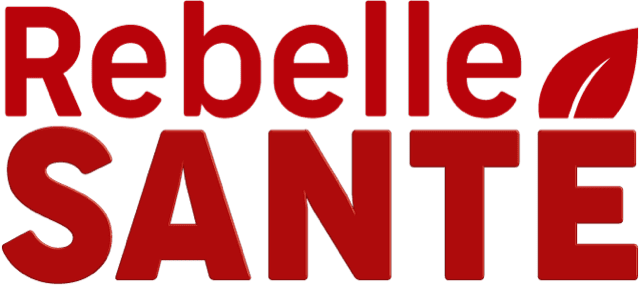La parole : du souffle au son
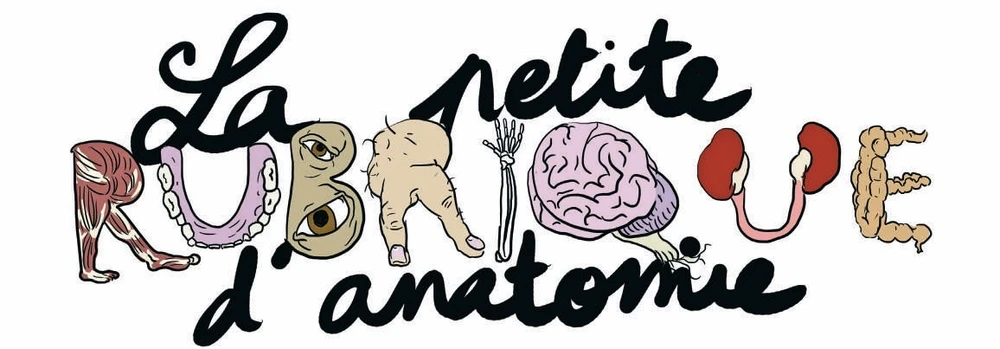
Le mois dernier, nous avons parlé de la naissance de la parole dans le cerveau. Pour que cette parole se fasse entendre, il faut d’abord qu’elle soit transformée en son. Je préfère faire un avertissement préalable : dans cet épisode, vous verrez plusieurs illustrations de cordes vocales. Si vous êtes tentés d’y voir autre chose, c’est votre esprit qui est mal placé et non celui de l’illustrateur qui a cherché à représenter fidèlement cette partie du larynx essentielle à la vocalisation.
Avant d’étudier le larynx, il faut remonter à la source du souffle : direction les poumons. Pour aborder le rythme inspiration/expiration, nous allons plutôt parler de ventilation pulmonaire que de respiration, qui concerne davantage les échanges d’oxygène et de gaz carbonique. Ce sera peut-être l’objet d’une autre rubrique, mais pour l’instant, ce qui nous intéresse, c’est de créer du vent avec notre système respiratoire.
Les poumons sont deux gros sacs remplis de tuyaux qui ne se meuvent pas tout seuls. Ils sont attachés à la cage thoracique par la plèvre (une double membrane), et c’est la cage thoracique elle-même qui bouge et se déforme grâce à l’action de certains muscles : des muscles du cou, des muscles entre les côtes (ce qui, en boucherie, correspond aux travers de porc) et surtout le diaphragme qui se trouve sous les poumons.
Lorsque l’on inspire, les muscles “étirent” les poumons, ce qui crée un vide et aspire l’air ambiant. L’expiration est passive : c’est en relâchant les muscles que la cage thoracique reprend sa forme initiale dans laquelle les poumons sont plus à l’étroit. On le remarque bien lors des crises de myoclonie phrénoglottique : le diaphragme se contracte involontairement vers le bas, diminuant la pression à l’intérieur des poumons tandis que la glotte ferme l’arrivée d’air, ce qui crée une sensation d’inconfort qui se répète à chaque contraction. On peut aussi dire hoquet, mais myoclonie phrénoglottique, ça en jette un peu plus.
Pour pouvoir parler, il faut maîtriser son expiration qui, jusque-là, fonctionnait en mode automatique grâce au centre respiratoire présent dans le tronc cérébral, situé sous le cerveau. Quand on parle, le cortex pré-moteur (situé juste à côté de l’aire de Broca, souvenez-vous, le mois dernier) s’active, il transmet ses infos au cortex moteur qui, lui, donne l’ordre aux muscles de s’activer. C’est ainsi que l’on prend le contrôle de son diaphragme, de ses muscles intercostaux et du cou, et surtout que l’on actionne les muscles abdominaux pour comprimer la cage thoracique, et ainsi expirer de façon active.
Pour résumer : la ventilation pulmonaire automatique se contente de contracter les muscles qui aspirent l’air, et c’est leur relâchement qui chasse l’air. Pour parler, comme il faut maîtriser l’expulsion de l’air, nous prenons le contrôle de ces muscles tout en activant les abdos qui compriment les poumons.
Bien sûr, si la ventilation pulmonaire est troublée, la voix risque d’en pâtir : un problème au niveau de la plèvre, des côtes ou des muscles respiratoires, et la parole trinque, c’est évident. Essayez donc de parler pendant une quinte de toux.
Pour lire la suite
Avec Rebelle-Santé, découvrez les bienfaits de la santé naturelle et des médecines douces ! Notre magazine est totalement indépendant, chaque article est soigneusement rédigé (par des humains) dans votre intérêt exclusif. Aucune publicité déguisée. En vous abonnant, vous aurez accès à plus de 10 000 articles et 45 nouveaux articles chaque mois.
Déjà abonné·e, connectez-vous !