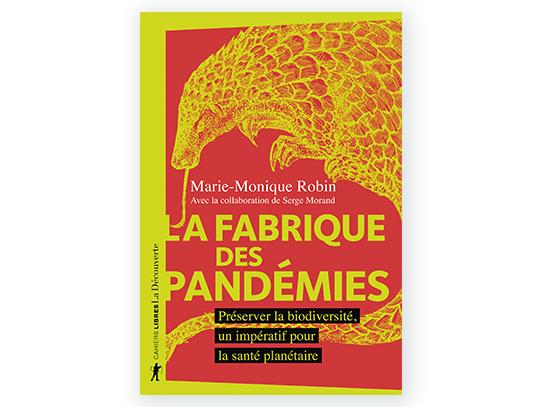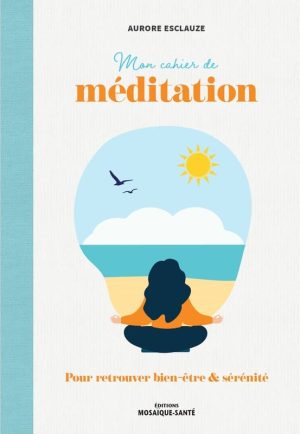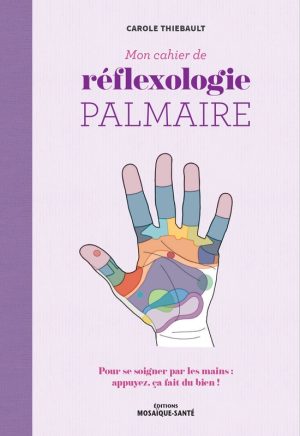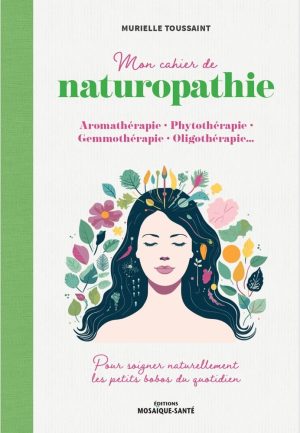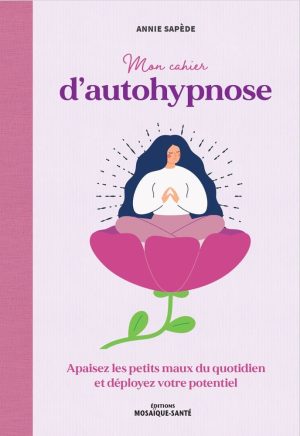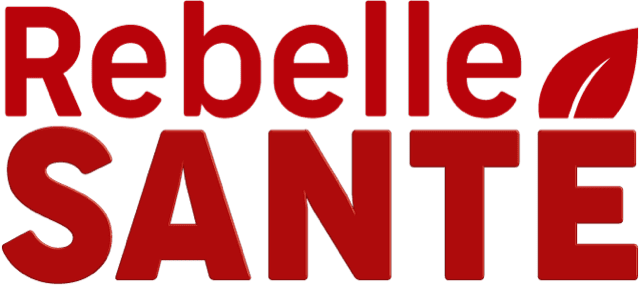Une crise de la sensibilité moderne
Penser la violence des humains contre l’environnement

Dans L’animal et la mort, l’anthropologue Charles Stépanoff analyse le rapport à la violence infligée aux animaux dans nos sociétés occidentales. Pour lui, en Occident, la sensibilité exacerbée par le désir de protection de la nature et la barbarie de l’exploitation industrielle sont directement liées. Elles sont l’âme et le corps de la modernité. Rencontre.
Charles Stépanoff a grandi en banlieue parisienne. Rien ne prédestinait ce normalien à étudier les liens des sociétés humaines avec l’environnement. Pourtant, après avoir étudié le chamanisme auprès des populations sibériennes de la taïga, c’est en France qu’il a choisi d’interroger notre rapport au sauvage autour de la pratique de la chasse dans le Perche, la Beauce et les Yvelines de 2018 à 2020. Sans parti pris pro ou anti-chasse, il étaye ses réflexions d’une profondeur historique qui éclaire les enjeux de notre rapport à la nature en soulignant l’ambivalence de la conscience humaine face à la violence.
Rebelle-Santé : Pourquoi après la Sibérie, avez-vous décidé de revenir en France pour enquêter près de chez vous sur les rapports que nos sociétés entretiennent avec les animaux sauvages ?
Charles Stépanoff : Quand j’étais étudiant en philosophie, j’essayais de comprendre les usages déviants du langage : j’ai commencé par la parole poétique et je suis passé à la parole magique, au langage rituel. Pour apporter des éléments concrets sur ces questions, il a fallu abandonner la philosophie et passer à l’anthropologie en menant des enquêtes de terrain chez des gens qui agissent sur le monde par la parole. Je les ai trouvés parmi les chamanes tuva en Sibérie et j’ai étudié les traditions et le mode de vie des éleveurs-chasseurs de cette région pendant quinze ans. Ensuite, il y a quelques années, je suis passé par un cancer et une chimiothérapie, de sorte que je ne pouvais plus aller dans la taïga pour un moment. Le cancer nous rend myope, on ne voit plus très loin ni dans le temps ni dans l’espace, on apprend à regarder autour de soi et à se contenter de peu. Dans mon métier, cela m’a poussé à tenter une ethnographie du proche, une ethnographie en circuit court. C’est pour cela que j’ai décidé d’enquêter sur le rapport aux animaux sauvages près de chez moi, en me servant des questions et des outils d’analyse que j’avais mis au point en Sibérie.
Le point de départ de votre livre, le coeur du sujet, c’est l’analyse de la violence anthropique (perpétrée par des humains). En quoi ce rapport à la destruction de la nature et à la mort des animaux structure-t-il les sociétés humaines ?
Il s’agit de prendre conscience de la part de violence qu’implique l’existence des sociétés humaines, quels qu’en soient le mode de subsistance et l’organisation sociale. Les ethnologues savent bien que le thème des “sociétés primitives vivant en harmonie avec la nature” est un mythe de civilisés. Parmi les choses qu’un ethnologue occidental doit apprendre quand il arrive sur le terrain, il y a le fait de tuer des animaux, les dépecer, abattre des arbres, défricher des jardins, etc. Tout cela implique la destruction de vies animales et végétales et la perturbation de milieux. Une étude récente a montré que depuis 12 000 ans, les trois quarts des surfaces terrestres de la planète sont modifiés par les activités humaines de chasse, brûlis, cultures. Il est donc essentiel, d’un point de vue anthropologique, de se demander comment les sociétés humaines organisent et conceptualisent cette violence anthropique et pourquoi nous avons si peu l’habitude de la voir en Occident.
Pour lire la suite
Avec Rebelle-Santé, découvrez les bienfaits de la santé naturelle et des médecines douces ! Notre magazine est totalement indépendant, chaque article est soigneusement rédigé (par des humains) dans votre intérêt exclusif. Aucune publicité déguisée. En vous abonnant, vous aurez accès à plus de 10 000 articles et 45 nouveaux articles chaque mois.
Déjà abonné·e, connectez-vous !