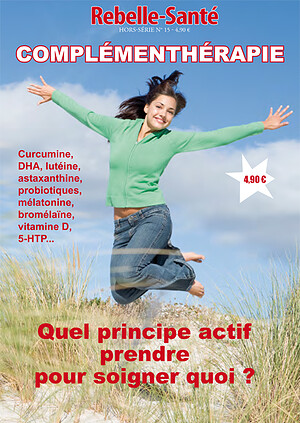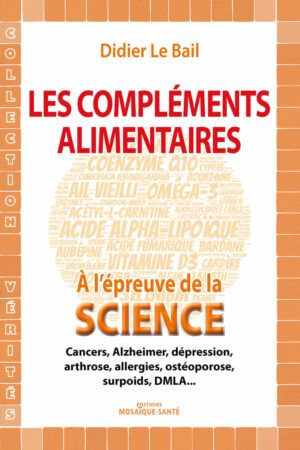Syndrome de fatigue chronique
Mieux comprendre la maladie pour mieux la soigner

Curieuse coïncidence : le jour même où j’ai commencé à rédiger cet article, un grand quotidien national consacrait une page au syndrome de fatigue chronique (SFC). On pouvait y lire le témoignage émouvant d’une ancienne candidate d’un télé-crochet victime d’une mononucléose alors qu’elle était en studio pour l’enregistrement de son premier album. Cette infection virale éprouvante précipita l’apparition d’un SFC qu’elle n’est toujours pas parvenue à surmonter 5 ans après. Entre-temps, elle a dû tirer un trait sur une carrière musicale qui s’annonçait pourtant prometteuse. Elle est aujourd’hui âgée de 26 ans.
Il ne s’agit pas d’un cas isolé, loin de là. On estime que le SFC concerne 800 000 à 2 500 000 personnes aux États-Unis, environ 250 000 personnes en Grande-Bretagne et 150 000 en France. Au même titre que les adultes, les enfants et les adolescents peuvent eux aussi être touchés par cette affection.
La reconnaissance du SFC en tant qu’entité pathologique ne date que du début des années 90. Comme les causes de ce syndrome demeurent inconnues pour la médecine conventionnelle, certains doutent encore de la réalité de la maladie ou la décrivent comme une variante moderne de la neurasthénie. D’autres commettent aussi l’erreur de la confondre avec la dépression, alors qu’on ne rentre pas dans la maladie à cause de la dépression.

Schisandra
La maladie, de l’intolérance systémique à l’effort
Dans le but d’améliorer la reconnaissance de la maladie, l’Institute of Medicine – l’équivalent américain de notre Haute Autorité de Santé (HAS) – a proposé, l’année dernière, de modifier l’appellation de la maladie, dont le nouveau nom est désormais « maladie de l’intolérance systémique à l’effort » ou « MISE« , pour faire plus court.
Un nom à priori peu explicite mais qui, pour le Dr Peter Row, de l’Université Johns-Hopskins (USA), « décrit vraiment beaucoup plus directement la principale caractéristique de la maladie, qui est l’incapacité de tolérer l’effort physique et l’effort cognitif« . À travers ce nouveau nom, l’accent est donc davantage porté sur le malaise post-effort que sur la notion relativement « vague » de fatigue persistante.
Nouveaux critères de diagnostic
L’Institute of Medicine a profité de ce changement de nom pour revoir et simplifier les critères de diagnostic de la maladie qui sont maintenant les suivants :
- Réduction substantielle ou incapacité d’entreprendre les activités professionnelles, sociales, éducatives ou personnelles habituelles de la période antérieure à l’affection, et ce depuis plus de 6 mois et en raison d’une fatigue souvent profonde nouvellement apparue et qui ne résulte en aucune manière d’efforts actuels excessifs et qui n’est pas soulagée substantiellement par le sommeil.
- Malaise post-effort, qu’il soit physique, cognitif ou émotionnel.
- Sommeil non-récupérateur.
- Au moins une des deux manifestations suivantes :
– difficultés cognitives (troubles de la concentration, de la mémoire…)
– intolérance orthostatique (incapacité à rester debout longtemps).
Le diagnostic de SFC n’est posé qu’une fois exclues toutes les affections susceptibles de présenter des symptômes plus ou moins comparables : troubles du sommeil, burn-out, hypothyroïdie, anémie…
Le syndrome de fatigue chronique vu d’Extrême-Orient
À l’autre bout du monde, on s’interroge aussi sur les causes du SFC. En se fondant à la fois sur l’abondante littérature scientifique à disposition et les enseignements millénaires de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), des chercheurs de Hong Kong en sont venus à distinguer deux grands types de syndrome : le premier est avant tout lié à un dysfonctionnement des mitochondries et le second, à un dysfonctionnement de l’immunité consécutif à une infection aiguë. Bref, le premier type renvoie à la piste énergétique et le second, à la piste infectieuse. Les personnes les plus jeunes – disons celles en-dessous de 25 ans – sont plutôt concernées par le second type, qui apparaît de manière assez brutale, à la suite d’une infection le plus souvent d’origine virale. C’est exactement ce qui s’est passé pour l’ancienne candidate du télé-crochet.
L’origine énergétique de la maladie
Dans le premier type de SFC, le fonctionnement défectueux des mitochondries crée une véritable « crise énergétique ». Comme l’explique le Dr Richard Horowitz, « les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule. Si elles sont endommagés par des radicaux libres ou des substances chimiques toxiques, elles ne peuvent plus fonctionner correctement, avec pour résultat éventuel une fibromyalgie ou un syndrome de fatigue chronique, ainsi que de nombreux symptômes neurologiques, neuropathiques notamment » (1).
Pour à la fois restaurer l’équilibre Yin/Yang et améliorer le fonctionnement et le rendement énergétique des mitochondries, les chercheurs de Hong Kong préconisent de recourir à deux plantes adaptogènes : la cistanche et le schisandra.
- Surnommée le « ginseng du désert », la cistanche est une plante antifatigue, anti-âge et neuroprotectrice – au point qu’en Chine, elle a obtenu le statut de médicament dans le traitement de la maladie d’Alzheimer ! Malheureusement, la cistanche est introuvable en France et même en Europe à cause d’une réglementation européenne « mal foutue » qui, pour l’heure, empêche sa commercialisation.
- En revanche, le schisandra, dont on utilise les baies pour leur action revitalisante, est disponible sur le marché français. Capable d’améliorer le statut antioxydant mitochondrial, le schisandra est tout particulièrement conseillé en cas de fatigue intellectuelle, de brouillard mental (« brain fog »). Il a aussi pour vertu de régulariser l’oxygénation cellulaire. Le naturothérapeute Daniel Kieffer rappelle que « l’URSS l’a utilisé pour ses pilotes d’avions dans les années 40, alors que les masques à oxygène n’étaient pas encore très répandus« .
– Posologie pour le schisandra : jusqu’à 2000 mg par jour en deux prises (matin, midi). Cures discontinues (ex : 15 jours OUI, 15 jours NON, ou 20 jours OUI, 10 jours NON).
– Contre-indications : grossesse, ulcère gastrique.
L’origine infectieuse de la maladie
De nombreux agents infectieux dont le système immunitaire n’a pas pu se débarrasser complètement sont impliqués dans le déclenchement et la chronicisation de la maladie. Ils sont à l’origine d’infections aiguës temporaires (« infections chaudes ») et d’infections latentes permanentes (« infections froides »). Il n’est pas rare que l’infection initiale passe inaperçue et que l’on devienne porteur sain d’un agent infectieux susceptible de se réactiver à l’occasion d’une baisse des défenses immunitaires.
La piste virale
Quels sont donc ces agents infectieux que le système immunitaire se montre incapable d’éradiquer ? Il s’agit majoritairement de virus. En tête de liste figurent les virus herpétiques, en particulier le virus Epstein-Barr, à l’origine de la mononucléose, et l’herpès simplex virus de type 6, dont 90 % des enfants sont déjà porteurs avant l’âge de 2 ans. Ce virus est particulièrement retors car son ADN peut intégrer le matériel génétique du porteur. Du coup, plus rien n’empêche qu’il soit transmis du parent à l’enfant !

Reishi
- Pour combattre la fatigue, renforcer l’immunité naturelle et tenir en respect les virus herpétiques – surtout en période de stress –, quoi de mieux que le reishi, à condition que ce champignon médicinal soit issu de l’agriculture biologique et titré à 20, voire 30 % en polysaccharides.
– Il n’existe pas de posologie standard. Pour tout de même donner un ordre d’idée, on peut partir sur une base de 600 mg par jour pour un produit titré à 30 % et de 900 mg par jour pour un produit titré à 20 %. Privilégier les cures discontinues (3 semaines par mois, par exemple).
À noter que des entérovirus peuvent aussi être suspectés en cas de fatigue chronique associée à des troubles intestinaux chroniques. Puisqu’on en est à parler d’intestin, sachez aussi qu’un lien a été établi entre syndrome de l’intestin irritable, fatigue chronique et infection à Giardia intestinalis, un parasite de la famille des protozoaires.
La piste bactérienne
La bactérie la plus incriminée à l’heure actuelle est Borrelia Burgdorferi, transmise par les tiques et responsable de la borréliose ou maladie de Lyme. Une étude réalisée en l’an 2000 par des chercheurs allemands auprès d’environ 1200 hommes jeunes en bonne santé a montré que ceux porteurs d’anticorps anti-borrelia étaient plus souvent sujets à la fatigue chronique que les autres.
Hormis la fatigue, voici quelques-uns des autres symptômes les plus évocateurs d’une maladie de Lyme : douleurs musculaires et articulaires migrantes, nuque raide, maux de tête, troubles cognitifs, troubles du sommeil, troubles de la sensibilité (fourmillements, picotements…), hypersensibilité à la lumière et/ou au bruit. Le traitement d’une borréliose déjà bien installée est particulièrement ardu et nécessite un suivi thérapeutique (2).
Des « tueurs » d’ADN mitochondrial
Existe-t-il de possibles convergences entre piste énergétique et piste infectieuse dans le syndrome de fatigue chronique ? Une première réponse a été apportée en 2007 par des chercheurs américains. Ils ont en effet démontré en laboratoire que les virus de l’herpès simplex sont capables de dégrader complètement l’ADN mitochondrial dès lors qu’ils se sont « réveillés ». Or, l’ADN mitochondrial contient de nombreux gènes codant des protéines directement impliquées dans la production d’énergie !
Hormis leur rôle crucial dans la production d’énergie, les mitochondries aident aussi à orchestrer les défenses antivirales au niveau cellulaire. Au besoin, elles se chargent de déclencher le mécanisme de suicide cellulaire si elles jugent que la cellule n’est plus viable.
(1) Pour en apprendre davantage sur les mitochondries, se reporter à mon article récent sur « Médecine mitochondriale, médecine d’avenir ? » (n° 181)
(2) Un ouvrage de référence pour aller plus loin, celui du Dr Richard Horowitz : Soigner Lyme & les maladies chroniques inexpliquées (Thierry Souccar Éditions).